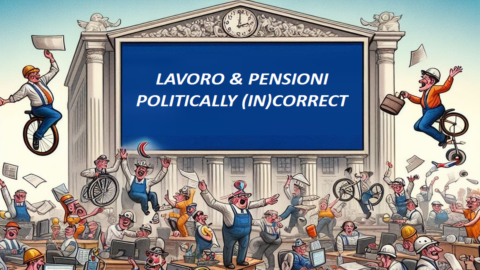"Fiat continuera à fabriquer des voitures. Mais la vraie question est de savoir ce que l'Italie a l'intention de faire, si l'Italie veut fabriquer des voitures. Il faut créer les conditions pour investir dans le pays ». Parole de John Elkann, président de Fiat, qui revêt une valeur particulière compte tenu de la situation économique "chaude", pas seulement en termes de météo, en Italie et dans le monde.
Fiat, affirme l'actionnaire numéro un du groupe, ne change pas ses stratégies face à une crise sans doute bien plus grave que les propres projections de Lingotto : le marché italien, comme le rappelle Sergio Marchionne, est au plus mal de 1996 à aujourd'hui ( mais peut-être que les choses sont encore pires, a-t-il souligné) ; aux États-Unis, désormais deuxième patrie du groupe, les ventes de 12,5 millions d'unités en 2011 n'iront pas au-delà, comme le prévoyaient déjà les plans, prudents pour Chrysler (mais espéraient quelque chose de plus) ; la chute brutale des actions en Bourse (42% depuis début août) pourrait faire trembler l'entreprise la plus solide de la planète, ce que Fiat n'est certainement pas.
Dans ce contexte, la tentation de se réconcilier avec ceux qui soutiennent qu'"aujourd'hui Fiat a besoin de l'Italie" pourrait surgir, incitant implicitement à prendre du recul par rapport au Lingotto en termes de choix d'investissement ou dans les relations avec le syndicat ou la politique. Mais Elkann a explicitement rejeté cette voie : Fiat, une entreprise dirigée par une famille qui a affronté des tempêtes financières et économiques tout aussi violentes dans son histoire, n'entend pas changer de cap. Au contraire, elle continuera à produire des voitures, compte tenu de la fusion avec Chrysler, qui a porté le potentiel de production à 4 millions d'unités, un pas vers l'objectif des 6 millions de voitures, seuil critique pour être un constructeur mondial.
En attendant, le groupe n'abdique pas ses racines italiennes. Loin de là : l'hommage de Sergio Marchionne et John Elkann au président Giorgio Napolitano le prouve ; ceci est confirmé par la franchise avec laquelle Elkann et Marchionne interviennent sur le dossier italien.
Le problème, disent-ils, n'est pas seulement ni surtout la dette publique. Le véritable point crucial concerne la crédibilité du pays, à la fois en termes d'engagements fiscaux et financiers, et en tant que lieu de travail et de développement. Tous deux, surtout, sur le front de la moralité de la classe dirigeante. Bref, ce n'est pas le moment de demander "l'aide" du budget public ou de dire merci si, enfin, dans le cadre de la manœuvre, la réalité des relations du travail telles qu'elles sont réglementées dans le monde est reconnue (la "liberté du feu", comme on le résume hâtivement dans le jargon de tous les jours).
Bref, Fiat ne demande pas à lever des barrières pour le protéger dans un pays qui persiste à défendre la diversité de sa clientèle, mais, au contraire, se propose comme point de référence pour réduire l'écart entre l'Italie et ce qui se passe dans le reste du l'économie mondiale. C'est vrai pour les relations sociales, qui ont suscité les foudres d'une partie de la gauche et beaucoup embarrassé les structures de la Confindustria, mais c'est aussi vrai pour l'approche de la dette publique. L'élan de Luca di Montezemolo en faveur d'un capital social pour les super riches ne déplaît pas (voire comme) Marchionne et, probablement, Elkann qui ne s'exprime pas explicitement pour ne pas trop impliquer Fiat dans des affaires qui n'appartiennent pas à le groupe. Mais force est de constater que la route est celle de la lutte contre l'évasion et de la contribution de solidarité versée par ceux qui peuvent donner et qui ont tant eu dans ces années de croissance à l'avantage des profits et des revenus mais qui ont pesé sur les épaules des classes moyennes et des plus pauvres. C'est la voie principale, bien plus que l'augmentation des impôts, dont la TVA, qui ne peut avoir que des effets dépressifs sur la demande et, par conséquent, sur l'économie.
Bref, en résumé : 1) la crise ne change pas les stratégies de Fiat ; 2) la décision de se concentrer sur l'Italie, au-delà de ce qui a déjà été décidé pour Pomigliano, concerne davantage le pays que Fiat lui-même qui, vis-à-vis des actionnaires, ne peut accepter un traitement de faveur pour le Bel Paese ; 3) le groupe non seulement ne renie pas ses racines italiennes mais entend continuer à avoir son mot à dire sur le dossier italien ; 4) L'entrée de Luca di Montezemolo dans le peloton n'implique pas Fiat mais bénéficie de la sympathie absolue de Marchionne et Elkann.
Alors, malheur à mettre une étiquette favorable au centre-droit ou à gauche sur la tête de Lingotto. Ou d'élever l'éternel refrain sur les aides reçues au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, comme alors, en réalité, Fiat a joué un rôle essentiel pour maintenir le pays accroché au peloton de tête des pays civilisés. Et il compte bien le refaire, comme ce qui se passe en Pologne ou au Brésil. Même si le chemin, en ces temps de baisse de la demande et de pression financière croissante, ne sera pas facile. Mais tout est possible quand on est crédible. "Je suis prêt à tout pour aider le pays si l'objectif est clair", a déclaré Marchionne. Peut-être même pour déplacer sa résidence fiscale, si cet acte n'apparaît pas comme un chantage démagogique : le PDG de Fiat n'a pas à craindre les taxes sur ses stock-options très médiatisées alors qu'elles valaient des centaines de millions, oubliées aujourd'hui alors qu'elles sont en pratique finies en fumée avec les rabais de ces jours.