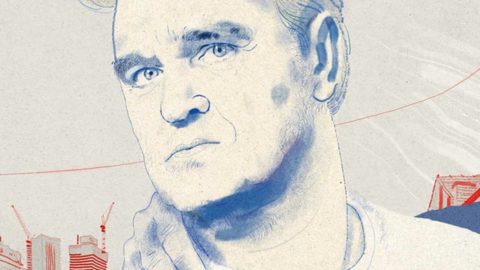Le rideau se lève sur une scène sombre et noire. Pendant quelques instants une mélodie se fait entendre au loin, presque imperceptible, une voix mélancolique et des notes graves en arrière-plan ; après quoi la musique s'arrête et la scène commence à s'illuminer. La lumière est blanche, forte, et au centre de la scène se trouve une table en bois, également blanche. Au-dessus est assise une femme brune, pieds nus et dans des vêtements déchirés, avec ses jambes et ses pieds suspendus en l'air et ses bras mous à ses côtés. Sa tête est inclinée, flasque, comme sans vie. Devant elle, des chaises renversées, aussi blanches que la table. La lumière augmente d'intensité. La femme lève la tête et regarde droit devant elle, au-delà des chaises et de l'avant-scène, dans le public ; son visage est trop maquillé, défait. La lumière augmente à nouveau, mais uniquement sur la scène. La femme écarquille les yeux tout autour, dans la chambre noire, sort un stylo et le retourne dans ses mains en le pesant. Tout est calme. Enfin, il descend de table et commence l'histoire, stylo à la main.
Parfois – parfois j'avais le sentiment que j'étais vraiment lui. Un brin d'air m'a suffi, un dimanche pluvieux, quelques heures de solitude et d'ennui et d'un coup je me suis transformé en Morrissey, sérieux, je suis devenu l'ancien chanteur des Smith, la fin de ma vie et mon obsession, mon condamnation. J'ai pu me tortiller dans le noir pendant des heures, seul, traînant ma voix et mon corps et m'offrant au monde entier, au public et à ma chambre vide. Je suppose que je peux le refaire, même ici, en grimpant sur la table et en utilisant ce stylo comme un microphone, comme un sceptre. Mais ce serait un spectacle horrible, et au fond de moi, je sais que tu te fiches de ma voix : tu veux connaître mes blessures, mes obsessions, mes maux et ainsi de suite, même mes fantasmes et ma violence, je suppose, comme si ma relation avec Morrissey était unique, comme s'il n'avait rien à voir avec moi et avec ma "maladie", si on veut la définir ainsi.
Parce que pour vous, mon Moz bien-aimé n'est rien de plus qu'une autre pop star des années XNUMX, un mélange entre Frank Sinatra, Elvis Preasley, John Lennon et qui sait qui d'autre, rien d'unique ou de transcendantal ; vous n'avez pas l'air très intelligent, musicalement parlant. Quand je t'ai demandé si tu le connaissais, je savais que tu dirais non, ou du moins que tu te blottirais, peut-être que tu ferais semblant d'avoir entendu une chanson ou deux, pour entrer dans mes bonnes grâces. Mais quand j'ai rétorqué gravement : "Morrissey pourrait vous sauver la vie", vous n'auriez pas dû sourire ces sourires, mes inquisiteurs, ni me fréquenter lors de visites futures, sinon vous finirez directement dans le trou plutôt que dans mon bien. grâces, ma haine, parmi mes victimes.
Je ne peux pas en être sûr, mais je pense que j'ai rencontré Morrissey pour la première fois en 1995, l'hiver de mon treizième anniversaire et la sortie de Grammaire gaucher, son cinquième album solo. Je n'étais alors qu'une petite fille, et pourtant je commençais déjà à lutter entre une adolescence solitaire et humiliante et des rêves séditieux et pervers, les italiques sont obligatoires, résultat de journées passées à la bibliothèque ou au lit, en contemplation. Il va sans dire que Morrissey a vécu quelque chose de similaire à Manchester dans les années XNUMX – « I was born in Manchester, in the Central Library, Crime section » – entre poésie et solitude, obsessions et pluie, et c'est l'une des pierres angulaires de notre relation. . Un autre point d'appui est la musique, ou plutôt sa voix et ses paroles, ses poses sur scène et dans la vie ; parler de chansons simples serait réducteur, injuste.
Tout à coup, en effet, ce fut comme si quelqu'un, un être à la fois adorable et maudit et tendrement rebelle, s'était glissé dans ma chambre et m'avait chante ma solitude, ma splendeur et ma misère humaine, mon incapacité à aimer, à être aimé. Morrissey ne m'a pas promis de sexe, de fumée, de drogue, de vie sur Mars ou d'autres commodités, mais il savait chanter et souffrir avec moi, et cela me suffisait. Ses vers poignants et ambigus m'ont révélé que nous étions seuls dans un monde sans espoir, et c'était bien; ou c'est parti, ce qui était suffisant. J'avais treize ans puis quatorze, quinze, seize, dix-sept ans, je suis entré dans l'âge adulte et le troisième millénaire en sachant que "l'an 2000 ne changera personne ici, Comme chaque promesse légendaire vole si vite», et pourtant il m'a appris à apprécier le vide dans mes poches et dans ma vie, ma solitude et mon ennui, mon mépris, mes sautes d'humeur, mes traînées de sang dans les toilettes. En bref : Morrissey m'a aidé à vivre, il m'a donné une identité et un homme à aimer, lui. Quand il est sorti Sang irlandais, Coeur anglais ( "il n'y a personne sur terre dont j'ai peur...") J'avais vingt-quatre ans, et je me suis résolu à quitter l'Italie et à le voir en direct, à Manchester, à l'Arena, et c'était un spectacle indimenticabileIl n'y a pas d'autres mots pour le décrire.
La foule m'a claqué entre les barrières et les coudes et les bras tendus vers lui, sur scène, droit et immense dans sa chemise blanche, irréel mais réel, grand, déterminé, lumineux, chair et sang et jeans et cowlick, agitant le fil du micro ou marchait parmi les notes, me regardant droit dans les yeux, chantant pour moi. Une seule personne au monde peut comprendre l'importance physique de Morrissey, pour ses fans – et c'est Morrissey lui-même. Morrissey, qui a déclaré: «J'admire ceux qui atteignent des jalons artistiques importants après avoir subi des flagellations publiques répétées, après avoir été brûlés vifs par des critiques et avoir de nombreuses portes fermées au visage. J'aime quand ils arrivent au sommet, souriants, maîtrisés, inébranlables. À mon avis, ces exemples doivent être précieux ». Là: j'ai chéri Moz pendant des années et des années, et ce soir, après l'épopée Il y a une lumière qui ne s'éteint jamais, En passage souterrain assombri J'ai repris courage et j'ai décidé de lui offrir mon corps, mon esprit et mes peurs, tout ce que je possédais. J'ai décidé de ne plus vivre qu'à Morrissey, pour Morrissey. J'ai décidé d'en faire une religion.
Pour être précis, j'ai bien peur que "décider" ne soit pas le bon verbe. Je n'ai aucune difficulté à l'admettre : mon état psychique était si fragile qu'il annulait toutes mes volontés, toutes mes pensées ; Je n'avais pas (je n'ai pas) de travail, de famille, de petit ami, d'êtres chers ou de photos à accrocher et de dates à retenir ; Je n'avais pas de vie, rien. Mon frère, le seul parent digne d'être mentionné ici, ne serait-ce que pour la haine que cet infâme bâtard a pu attiser en moi, a refusé de me parler ou même de me regarder, me considérant comme un « hystérique asexué et un débile mental, ou peut-être un prétendant à l'héritage, je ne sais pas. Pas que je m'en soucie beaucoup : je le voyais à peine, ne quittant jamais ma chambre et prolongeant indéfiniment mon adolescence, écoutant et réécoutant les Smiths et Morrissey à très haut volume, jour et nuit, me nourrissant tant d'amour : "Apprends à m'aimer, assembler les chemins… » ; combien de haine : "Je loue le jour qui t'apporte de la douleur... ".
La haine m'a en effet aidé à fortifier ma solitude, donnant un alibi à mon refus de vivre, d'être. Aujourd'hui encore, je me remets de dépressions à travers elle, à travers la haine, le mépris des pères, des mères, des enfants, des relations, des amours, du sexe, des êtres vivants et de tous les rebuts humains, à l'exception de Morrissey et de sa banane, bien sûr, et moi y compris. À ce stade, vous vous demandez peut-être : pourquoi n'y met-il pas fin, s'il déteste tant la vie et l'humanité ? Pourquoi ne pas dire au revoir au monde avec élégance, une corde autour du cou et un saut dans le vide ? Tout d'abord, je suis désolé de vous informer qu'à cet égard vous n'avez rien à dire, mes inquisiteurs, ne sachant pas ce qu'est la solitude, comme tout le monde. C'est-à-dire que je ne nie pas qu'au cours de votre existence vous puissiez vous sentir parfois vaguement "seul" et "désespéré", et pourtant la solitude est autre chose, croyez-moi, c'est une expérience terrible et fascinante, à partir de laquelle il y a pas de retour en arrière. À certains égards, c'est similaire à ces spots que vous me montrez ici, aux dessins multistables : vous les regardez et ils ressemblent à quelque chose, puis vous fermez les yeux et ils deviennent autre chose, vous les regardez plus attentivement et ils se transforment à nouveau , et ainsi de suite, tout le temps. 'infini, jusqu'à ce qu'il vous obsède et vous entraîne à l'intérieur d'eux, dans la solitude, qui est une tache ambiguë.
Y mettre fin n'est pas une solution, pas toujours, et en tout cas ce n'est pas du tout aussi simple ou évident que cela puisse paraître de l'extérieur. D'un autre côté, vous ne comprendrez jamais rien de tout cela, pas avec vos affections et vos alliances au doigt, sans vivre votre vie. Vous croyez que vous êtes et donc vous n'êtes pas, vous ne serez jamais, vous n'avez jamais été. Vous n'êtes même pas capable de fixer un mur sans ressentir rien, rien que le mur lui-même, l'atroce fixité de son être là et nulle part ailleurs, pour toujours, même après toi et après moi, même après Morrissey. Mais je complique un peu les choses, et au final il ne faut pas oublier que vous n'êtes que des commis, des domestiques, des éclaboussures de merde dans le seau de merde dans lequel je déconne, et qu'il est trop facile de vous humilier ou de vous détruire , mes inquisiteurs. . Mieux vaut retourner à Manchester, à la MEN Arena.
Alors ce concert a changé ma vie. De retour à Rome, j'ai pu pour la première fois sortir de ma chambre et m'ouvrir au monde, quoique virtuellement, à la recherche d'adeptes et de complices parmi les différents sites Internet et forums dédiés à Morrissey. J'avais sous-estimé l'importance et le potentiel du Net : en un mois j'ai sélectionné une vingtaine de guitaristes et batteurs ratés et j'ai procédé à des éliminatoires, jusqu'à ce qu'il m'en reste trois, à savoir les sosies de Johnny Marr, Andy Rourke et Mike Joyce, les autres membres de les Smith. Mon Johnny était un peu plus grand et boutonneux que l'original, mais il jouait d'excellents arpèges et était photogénique du public; quant à Rourke et Joyce, elles resteraient au fond de la scène, à l'ombre, éclipsées par la véritable star du groupe, à savoir moi, Morrissey – ou plutôt : une Morrissey en jupe, avec des bas noirs et des chaussons blancs. Les choses ont immédiatement commencé à prendre forme, à évoluer, sans trop d'effort de ma part. Johnny avait une certaine connaissance de la scène underground romaine, et réussit à organiser une quinzaine de soirées dans des clubs humides et claustrophobes, entre Testaccio et Prenestina. Le groupe s'appelait les garçons indisciplinés, des lignes: "Garçons indisciplinés / Qui ne grandira pas / Doit être pris en main», et se consacre exclusivement aux reprises des Smith, les imitant dans les moindres détails, des positions sur scène aux vêtements, en passant par le look.
Le public était partagé entre des passionnés de Smiths et des spectateurs occasionnels et un peu ennuyés, mais généralement ils ont tous applaudi, par pitié ou par politesse. Non pas que j'ai prêté attention à leurs applaudissements, pris comme je l'étais par mon spectacle et le jeu de guitare de Johnny. Je vivais les concerts en transe, comme si j'étais encore enfermé dans ma chambre, seul, protégé par les murs et les affiches de Moz, imitant sa voix chaude et sensuelle ou ses voix de fausset ironiques, ses poses. Je n'étais ni timide ni effrayé, ni mes inquisiteurs - j'étais simplement Morrissey, même loin de la scène, en relation avec Johnny et les autres. Quand ils sortaient chercher des filles, je faisais une moue hautaine et me retirais devant les œuvres d'Oscar Wilde, les méprisant silencieusement. Quant au véganisme ea La viande est un meurtre, il m'est arrivé de regarder dans des bouchers et des fast-foods et d'en donner aux passants connards cannibales, et un soir j'ai même fini par interrompre un concert au bout de quelques minutes, lorgnant le public et déclarant, comme Morrissey en Californie, au Coachella Festival 2009 : « Je sens la chair brûlée, et J'espère sincèrement que c'est de la chair humaine ».
Dans les conversations, cependant, je trouvais des phrases comme : « J'ai toujours été attiré par les gens qui ont les mêmes problèmes que moi, et ça n'aide pas quand la plupart d'entre eux sont morts », ou : « J'ai toujours dû rire de moi-même : si je n'avais pas trouvé mon statut social d'adolescent si ridicule, je me serais pendu », ou encore, paraphrasant toujours Morrissey, adressé aux mecs qui essayaient de m'inviter à dîner, trompé : « Si vous avait vécu ma vie pendant cinq minutes, vous auriez étranglé avec le premier morceau de corde à portée de main." Inutile de dire que Johnny et les autres me trouvaient insupportable, détestable. Quand, après le concert interrompu, Andy et Mike m'ont dit que j'étais folle hystériquement, j'ai rétorqué qu'en réalité ils n'étaient pas de vrais fans des Smith, et donc qu'ils n'avaient pas le droit de les entendre et de les jouer. Puis j'ai pointé Mike avec colère, ajoutant lentement: "Tu as plaidé et crié, et tu penses que tu as gagné, mais le chagrin viendra à vous à la fin… », et que ceux qui ont des oreilles pour entendre comprennent – certainement pas vous, mes inquisiteurs.
Cependant, cette querelle a marqué le début de la fin pour les garçons Unruly. Peu de temps après, un idiot a publié nos performances sur Internet, avec un son déformé et des images tremblantes, et des centaines de commentateurs et de prétendus fans de Moz ont commencé à me narguer et à m'insulter, me traitant de "perdant sans espoir", de "moule". . Par contre, je les ai compris : ils ont cliqué sur le lien de Ce Charmant man ou I savoir il est plus de et ils sont tombés sur l'un de nos misérables petits concerts, pas sur des spectacles en direct des Smith ou de Morrissey. Sur scène je l'ai imité discrètement, d'accord, mais à l'écran c'était tout autre chose, et le vrai Moz est inaccessible, je m'en rends compte. Un soir de dépression et d'ennui, sombrant sur Internet, l'abattoir mental de ma chambre et de ma vie, j'en suis même venu à insulter ma propre performance, comme pour m'en débarrasser. MAIS QUI SONT CES MERDES ?, ai-je écrit, avec un profil anonyme, et beaucoup de rires et autres insultes, et à ce moment-là, me détestant, j'ai décidé de ne plus chanter, sauf seul et dans ma chambre, comme avant. L'expérience des Unruly boys était terminée, me disais-je, comme celle des Smith en 1987. Il était temps de se lancer en solo.
Silence. En arrière-plan le chœur de Chaque jour est comme le dimanche, tandis que les lumières s'éteignent et que la scène devient grise. Jusqu'à présent, le silence et les premières notes de certaines chansons ont alterné pendant le monologue, entre des accords vifs, pressants ou mélancoliques. (Cet homme charmant, Nowhere fast, Cette nuit m'a ouvert les yeux) et marches funèbres (Le chagrin viendra à la fin). La femme parle tantôt d'un ton monotone et tantôt égayé, marchant sur scène et sur l'avant-scène, entre noir et blanc – que l'actrice est libre de bouger, de donner corps au texte. Maintenant, il laisse tomber son stylo et danse parmi les chaises renversées dans la pénombre, déplaçant la dernière au fond de la scène, la redressant et s'asseyant. Pendant quelques secondes, il ferme les yeux et passe ses mains sur son corps, toujours au rythme de Chaque jour est comme le dimanche, en extase, planant sur la musique ; après quoi les notes s'estompent et elle se redresse et regarde autour d'elle, comme si elle se réveillait. Tout est calme. La scène est en grande partie invisible, entre le gris et le noir, mais au bout d'un moment les chaises et la table s'illuminent à nouveau, et le blanc revient. La femme recommence à parler.
Viva Hate est le premier album solo de Morrissey, une étape difficile et très réussie, avec des chefs-d'œuvre tels que Daim e Tous les jours Is Like Sdimanche, mon favori. De nombreux critiques l'avaient abandonné après la séparation d'avec Johnny Marr, et à la place, il sort une série de singles inoubliables et se hisse au sommet des charts, quel mythe. La force de Moz, et par conséquent la mienne aussi, réside dans son talent pur et inextinguible, qui lui permet de faire et de dire ce qu'il veut, accablant les reines, les politiciens, les maisons de disques, les présentateurs de télévision, etc. De même, mes inquisiteurs, je pourrais e Je permettez-moi de faire ce que j'ai fait, non pas en mon nom mais au nom de Morrissey, pour honorer son talent. Ne voulant plus chanter en public, il fallait que je tente autre chose : un hommage esthétique, unique, un geste digne de Daim ou Viandes Is Mordre - comprenez vous?
"Meutre", précisément. Ma première victime s'appelait Giampiero Antoni, un homme de deux mètres, chauve et moustachu, né en 1958 et marié à Olga Antoni, une grosse femme en tablier blanc, également de Bari ou de Naples, ma deuxième victime. Ils tenaient une boucherie à la périphérie de Ladispoli, coupant continuellement du bœuf, des veaux, des vaches, des poulets, etc., un dégoût immonde. Je ne sais si les carnivores vous dégoûtent autant que Morrissey et moi, mes inquisiteurs, mais je vous assure qu'il y a quelque chose de terrible chez un homme qui plonge chaque jour sa lame dans les restes d'un faon ou d'une poule ; c'est un geste inhumain, atroce. Morrissey dit : « Nous sommes violemment dérangés quand des animaux mangent des hommes, c'est horrible, c'est terrifiant. Mais alors pourquoi n'aurions-nous pas horreur quand les hommes mangent des animaux ? ». Par contre, je vous garantis que les corps des époux Antoni étaient infiniment plus répugnants et fétides que la viande sans défense qu'ils hachaient et coupaient chaque matin ; ces salauds méritaient de mourir, en ce qui me concerne. Quant aux descriptions et au sang, je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé pendant et après la carnéficine, mais je ne pense pas avoir perdu la tête ni paniqué, non monsieur, malgré les entrailles éparses et les tranches de veau et de poulet alignées sur le comptoir. J'ai dû baisser le volet de la boucherie, traîner les corps à l'arrière et nettoyer le sol, en préservant les apparences - alors imaginez la "scène du crime", n'est-ce pas ? Puis je suis rentré chez moi et j'ai mis une chanson de Morrissey, bien que je ne sache pas laquelle, mes inquisiteurs. Il est probable que je voulais me reposer, dormir, et donc je me pencherais vers Souffrir, souffrir, peu les enfants, pièce ambiguë et tragique, propice aussi bien à la sieste qu'au massacre, selon les besoins. Mais je ne peux pas dire avec certitude.
Je peux vous révéler que j'ai encore tué à la place. C'était un été chaud et silencieux, comme dans un western, avec des rues désertes et des maisons vides, et Moz et moi n'avons pas pu résister à la tentation et avons travaillé dur pendant une semaine, tous les jours. Après la première victime, il s'avère que tuer un autre être humain est relativement simple, tant qu'il n'y a pas d'obstacles psychiques ou moraux, et nous n'en avions pas. Jusque-là, les bouchers romains avaient eu la vie facile, exterminant des milliers de poulets et de vaches en toute impunité ; en quelques jours nous en avons exécuté six, les uns après les autres, et ce fut un vrai plaisir, une libération. Je choisissais la bonne boucherie, je mettais des écouteurs, j'entrais et commandais une livre de bœuf, à hauteur de La viande est un meurtre ou Mort au coude, attendant le moment le plus propice, calme, prêt à faire le tour du comptoir et à surprendre le bâtard derrière, zac, un coup de poignard à la gorge, zack zack, un couple à côté, zac, une entaille à la poitrine, etc., écoutant toujours Morrissey, obéissant à sa voix. (En disant cela, il ramasse le stylo et le brandit en l'air, comme un couteau, pour ensuite le jeter dans le public, dans le noir - maintenant le stylo a disparu.) Personne ne soupçonne une femme seule, fragile et désespérée, heureusement ; personne ne soupçonne une femme, c'est tout.
La nuit, à la maison, j'étais épuisée et confuse, et parfois j'ai même ressenti le besoin de faire taire Moz et de m'allonger silencieusement sur mon lit, à regarder le plafond et l'espace, dans l'espoir de m'endormir. Pendant mon sommeil, cependant, les coups de couteau et les éclaboussures de sang m'ont réveillé encore et encore, brusquement, encore et encore, me fascinant et terrifiant à la fois, et pourtant le lendemain matin j'allais bien, et l'après-midi j'étais tue encore. De temps en temps, entre boucherie et sieste, je croisais mon frère dans l'escalier ou dans la cuisine, toujours avec Morrissey dans les oreilles, pourtant il ne remarquait rien, me regardant à peine. Mon frère a toujours été froid avec moi, distant, méchant, connard au-delà des mots. Après la mort de nos parents, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec cette histoire, nous avons partagé la maison pendant cinq ans, sans jamais se parler, chacun sur son territoire et suivant des règles précises, de l'interdiction de manger de la viande aux toilettes , lave-linge, lave-vaisselle, cuisinière et TV fois. Il ne m'a jamais aimé, et je ne l'aimais pas non plus. Le temps nous a rendus étrangers l'un à l'autre, je suppose, deux gars qui vivent dans la même maison et se méprisent pour des querelles depuis longtemps oubliées. J'ajoute ces détails parce qu'ils auront du poids dans l'histoire plus tard, mes inquisiteurs – sans cette petite merde, je ne serais pas là.
Mais revenons aux cadavres. Le vrai problème était le bruit, les cris des corps dégoulinants de sang et déjà condamnés, sans espoir de survie, les bouches qui émettaient des cris atroces et se glissaient entre Morrissey et moi, dans les écouteurs, ruinant la scène, bon sang. Je ne comprends pas pourquoi les êtres humains accueillent la mort avec terreur, puisque ça les arrache à une vie de merde. Entre autres choses, les cris m'ont fait infliger des coups de poignard sanglants plus profonds, répétés, furieux, jusqu'à ce qu'ils les fassent taire et fassent de leur corps une masse de sang et d'entrailles - c'est ce que je vois dans ces maudits dessins : du sang, des entrailles, des coups de couteau, la haine. Le seul boucher à s'être échappé, à bien y penser, était le moins bruyant de tous, le dernier. Après un coup, il était déjà à terre, silencieux et immobile, comme une pierre morte, par ruse ou évanoui, je ne sais pas. Je l'ai traîné à l'arrière sans aucun problème, convaincu qu'il était mort et content d'avoir fait un travail propre, dansant avec Morrissey, fredonnant avec lui. Dommage que le lendemain la boucherie ait ouvert à son heure habituelle, sans police ou quoi que ce soit du genre, et que le boucher, un nain musclé et tatoué, m'ait regardé par la fenêtre, me défiant de réessayer. Au début, je me suis mouillé – comment était-ce possible ? Je suis rentré chez moi instinctivement, sans réfléchir, j'ai pris le couteau et je suis redescendu à la boucherie. Je suis resté plusieurs minutes sur le trottoir, alerte, la main tremblante. J'avais peur. Qu'est-ce qui m'attendait là-dedans ? Si le nain a survécu au premier coup de couteau, ne pourrait-il pas aussi survivre au deuxième, troisième et ainsi de suite ? Étais-je capable de le tuer, avec tous ces muscles et ces tatouages ? Plus : et s'il m'avait tendu une embuscade, s'alliant avec d'autres bouchers ? Tandis que je me tourmentais de ces doutes, il ne cessait de me lancer de derrière le comptoir ses regards de nain, éventrant un veau et souriant, moqueur, sûr de lui, prêt à se défendre et à tuer, à me tuer. Je n'ai pas eu le courage de coller Morrissey dans mes oreilles cette fois-là. Je ne voulais pas le rendre complice de ma peur, de ma reddition, alors je suis rentré chez moi et je me suis couché, fixant le plafond jusqu'au soir, où je me suis endormi. J'ai fait des cauchemars dont je ne me souviens pas.
Le lendemain, j'étais un peu confus, j'en ai peur. Au début, j'ai pensé à retourner chez le boucher et à le tuer en un rien de temps, zac zac zac, mais ensuite j'ai décidé de laisser les boucheries tranquilles quelques jours, prudemment. Je suis sorti de la maison avec des écouteurs dans les oreilles, décidé à me promener, tout au plus à visiter le cimetière de Verano au rythme de Cimetière GAtes, un chef-d'œuvre. Mais juste au moment où je passais la porte et me glissais dans un couloir de pierres tombales et de mauvaises herbes, Cimetière GAtes s'est terminé et le morceau suivant de l'album a commencé, celui qui est sanglant À grande bouche Stricycles AGain« Douceur, douceur, I était uniquement plaisanterie, quand I a affirmé Valérie Plante. Je ferais comme fracasser chaque dent in Un flux efficace peut augmenter front… », et soudain un Chinois d'une douzaine d'années est apparu, un petit garçon tout de peau sur les os, des fleurs à la main. Il voulait me les vendre, me les donner, obtenir de la monnaie, décorer ma vie. Son corps devrait toujours être parmi les tombes et les herbes, mes inquisiteurs, bien que cette fois la pensée me dérange, car je n'aurais pas dû le tuer. Morrissey n'est pas raciste en effet. Les vers ambigus de Bengali Pplates-formes - "Oh, ranger Un flux efficace peut augmenter Occidental plans ainsi que comprendre / qui life is dur assez quand you appartiennent ici » – visent plus la misère de l'Angleterre que les Bengalis, et en tout cas ils sont inclus dans l'album Viva Hate, viva l'odio, et donc nécessaires, me semble-t-il. D'ailleurs définir La discothèque du Front national une pièce fasciste, comme le NME l'a fait à l'époque, est tout simplement idiote ; c'est à propos de art, et le fascistello de la chanson n'est qu'un musa, comme dans Sucreries Tendre Hooligan. Par contre Morrissey a clôturé la conversation sur son prétendu racisme dans l'album Vous Aêtes le Qdépêchez-vous, à partir de 2004 : «J'ai rêvé d'un temps où être anglais n'est pas banal, se tenir près du drapeau sans se sentir honteux, raciste ou partial… ». Il est également vrai que peu de temps après, il aurait défini les Chinois comme l'un sous-espèces, mais dans les interviews le Moz c'est toujours le Moz, et en tout cas les gooks traitent les animaux comme des bêtes, mes inquisiteurs, et ils le méritent.
Quoi qu'il en soit, sous-espèce ou pas, je n'aurais pas dû massacrer ce gamin, Morrissey n'aurait pas approuvé. Je suis parti du cimetière étourdi, transpirant, écoutant Panique et me disant que j'avais fait une erreur, un crime, et que je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne sais pas si tu l'as déjà regretté vraiment de quelque chose, de faire un geste terrible et irréparable et de revivre encore et encore les mêmes instants, la même horreur, la gorge déchirée et ensanglantée d'un enfant et ses gémissements gutturaux, monstrueux, éternels. J'avais déjà tué plusieurs personnes, mais pour la première fois j'ai ressenti quelque chose, et c'était horrible. J'ai retraversé la ville en pensant en finir au plus vite, courtisant la rafale du métro et tombant entre les voies, sous le train, me laissant submerger.
Mais je ne l'ai pas fait, et peu à peu Morrissey a eu raison de lui, me sauvant et m'entraînant avec lui, de sa voix, me pardonnant même...Ne ratisse pas mes erreurs, I savoir exactement ce qu'ils sont… » – et peut-être me louant, après tout ce garçon chinois était une victime sacrificielle pour lui. J'arrivai à mon palais encore trempé de sueur, mais plus calme. Je m'étais échappé. Tuer ce petit garçon avait été atroce, d'accord, et pourtant Moz pouvait tout se permettre, et moi avec lui. Je suis entré dans l'ascenseur au rythme effréné de La barbarie commence à la maison, dansant devant le miroir, je montai à mon étage, ouvris la porte et soudain je tombai sur mon voisin, chose très rare, juge ou avocat à la retraite, qui ne sortait jamais. Il me regarda longuement dans les yeux, comme si connaissait, me condamnant, puis je me suis avancé et j'ai tué à nouveau",Oh, beau diable”. Tout s'est passé par hasard, mes inquisiteurs, comme si je m'étais trompé d'ascenseur – « Tout est arrivé par accident, je suis descendu du mauvais ascenseur » : Morrissey en 1987, sur sa vie – et soudain je me suis retrouvé avec le cadavre d'un vieil homme dans ses bras, devant la maison.
je l'ai porté à l'intérieur; que pourrais-je faire d'autre ? Je l'ai traîné dans le couloir et l'ai appuyé contre le canapé, assis, les jambes allongées sur le sol. Sa tête oscillait d'un côté à l'autre, molle et sans vie, mais à part ça, il ressemblait à un clochard, pas à un cadavre. Je rejetai sa tête en arrière et le regardai droit dans les yeux, deux yeux larges et vitreux, et pour le moment, me souvenant de son regard accusateur de tout à l'heure, j'éprouvai un vague sentiment de remords et d'irrémédiabilité, comme pour le garçon chinois. Par contre, il faut dire qu'aucun des deux n'avait fait grand-chose pour rester en vie, laissant le couteau lui trancher la gorge et le ventre de part en part, sans se débattre. Parfois j'ai l'impression que c'est de leur faute, les victimes, comme si ils voulaient être tué, nous utilisant et nous obsédant, mes inquisiteurs.
Cependant, je suis resté allongé sur le sol pendant un long moment, avec Morrissey hurlant dans mes oreilles et dans une mare de sang, comme s'il regardait le vieil homme. J'étais brisé, épuisé. Quand j'ai vu les lumières s'allumer dans le couloir, je n'ai rien ressenti de particulier, si ce n'est la stupéfaction qu'il faisait déjà nuit dehors et que Morrissey ne chantait plus, et quand mon frère a regardé dans le salon et a laissé échapper un cri d'horreur Je n'ai pas dit un mot, détournant le regard. Il s'est approché et s'est penché sur le vieil homme, à quelques centimètres de mon visage, carrant ses épaules contre le canapé et tenant sa tête haute, pulvérisant du sang tout autour. "Mais c'est… le voisin," dit-elle. « C'est le voisin ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Que lui était-il arrivé ? N'était-ce pas évident ? Mon frère a déplacé son regard de moi vers le cadavre et vice versa, sans comprendre, de même qu'il n'avait jamais rien compris à moi et à ma vie, à mon esthétique, continuant à tenir le front de ce sale vieillard qu'il connaissait à peine. Et pourtant, grâce à ce geste, j'ai soudain ressenti quelque chose envers lui, une sorte de tendresse. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ? » répéta-t-il, essayant en vain de ranimer le vieil homme et pourtant s'adressant à moi, s'adressant à sa sœur. Et pendant un instant j'ai réalisé que pouvoir le vouloir bienJ'ai reconnu cette possibilité. Pendant un long moment inconcevable, j'ai réalisé que le sang signifiait quelque chose, à plus d'un titre, et que mon frère et moi avions tout faux, ruinant nos vies.
Il criait : « Il ne bouge pas, il est mort, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire ? », et j'ai pensé à ce « nous » et je me suis demandé pourquoi il ne m'avait pas parlé depuis des années – pourquoi ? Ou était-ce moi qui ne lui ai plus jamais parlé – mais pourquoi, encore une fois ? Et soudain, toute relation humaine m'a semblé tragique et terrifiante et j'ai bondi, comme en rébellion, et maintenant je me demande pourquoi il m'a crié ces mots, alors que je lui ai sauté dessus et l'ai poignardé à la poitrine, au cœur ; Je me demande pourquoi il a crié : « Arrête, Amelia ! Arrêt! C'est moi ! », et s'il ressentait de l'amour, de la haine, de la confusion, de la peur – ou s'il ne ressentait rien, comme je ne ressens rien.
JE. Lui, arrête, Amelia, arrête. Amelia, mes inquisiteurs. Les relations humaines sont tragiques et terrifiantes, mais il ne reste que musique et terreur, solitude et murs blancs. Il m'a fallu du temps pour le comprendre, et maintenant j'ai gâché ma vie. Quand mon frère a arrêté de crier mon nom, j'ai arrêté. Tout était silencieux. Éteindre les lumières (les lumières s'éteignent aussi sur scène, l'une après l'autre, accompagner sa voix; Amelia s'effondre entre les chaises, dans la pénombre) et accroupi parmi les cadavres, dans le sang, essayant de mourir moi-même, sans bouger ni respirer. Mais je n'en étais pas capable. Je ne peux pas le faire. D'un autre côté, Morrissey est également resté en vie, donc ce n'est pas ma faute. Je ne peux pas y mettre fin, pas encore – pas tant qu'il est vivant et qu'il chante. Je vais devoir rester ici longtemps, entre ces murs noirs, sombres, comme le monde qui t'entoure, comme mes mots. Je continuerai à vivre et à haïr. Ayez pitié de moi.
Rideau.
En direct de Morrissey
l'auteur
Edoardo Pisani est né à Gorizia en 1988 et a vécu à Buenos Aires, Riccione et Rome. Il a traduit et édité des textes pour certains magazines et en 2011, il a été sélectionné pour Scritture Giove au festival de Mantoue. Pour le moment, il écrit et travaille à Rome, avec goWare, il a publié la brochure Vomir le XXe siècle.