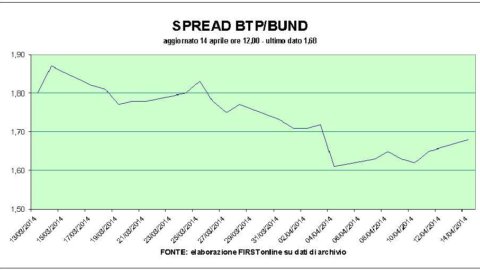Le pharmacien d'Alanno aurait voulu être fermier, un de ceux qui, lorsqu'ils vont à la messe endimanchés, portent des feuilles de basilic dans le creux entre l'oreille et la tempe, comme le font les menuisiers avec un crayon. Il regrettait d'avoir les mains trapues, sèches et gercées d'avoir travaillé à la campagne ; rentrer chez lui et, après avoir mangé de la sagne et des pois chiches à la sauce tomate, bousculer sa femme sur la table de la cuisine, sans cérémonies, à la va-vite et avec entrain, comme quand on sirote un bon café mais qu'on est pressé d'y aller. Puis, après avoir poussé un rot aigre et sonore, parfumé aux poivrons mangés la veille, approchez-vous lentement de la fenêtre et, le cure-dent dans la bouche et les mains dans les poches, regardez le maïs pousser.
Au lieu de cela, il n'avait rien du fermier, sauf la démarche paresseuse et légèrement avachie. Il n'était ni grand ni mince. Il portait des lunettes. Il avait peu de cheveux et un peu de pappagorgia. Il donnait plutôt l'impression d'un commis de bureau d'enregistrement. Pas ceux qui travaillent au comptoir, ceux qu'on ne voit jamais parce qu'ils travaillent dans les salles intérieures, dans les archives. Ceux qui ont la peau blanche comme de la gelée par manque de soleil et des cernes humides et livides par manque de femmes.
Selon le pharmacien, les paysans étaient une race pure, sélectionnés par des millénaires de contact avec la Nature. Ils en avaient tiré la sagesse, les gestes, le langage. Il aurait aimé être l'un d'entre eux, et il a perçu cette occasion manquée comme une nostalgie inconsolable continue.
Dans la pharmacie, lorsqu'un fermier entra et que sa bonne odeur d'écurie se répandit, il inspira de l'air pour s'oxygéner les poumons, comme s'il était en haute montagne. Et il est devenu vivant. Le sang coulait à nouveau dans ses veines. Il commença aussitôt à se plaindre de la pluie qui empêchait les semailles ; il maudit la grêle comme si elle lui avait fait du mal ; au moment des vendanges, il donne des conseils sur les doses de bisulfite à ajouter au moût, et recommande de respecter les lunes de décantation. Les paysans ne l'écoutaient plus, mais le remerciaient. Grâce non pas à ces suggestions inutiles, mais à l'amitié candide et enfantine que leur offrait ce sexagénaire fragile, inexpérimenté et extravagant avec une inquiétude excessive mais toujours respectueuse, naïve, sincère.
Le jeune boulanger était le premier client cet après-midi-là. Il était petit et rond. Il portait toujours avec lui l'odeur chaude des pains fraîchement cuits. Elle parlait vite et émettait des rires musicaux qui lui ont valu le surnom de Cinciallegra. Tout le monde dans le pays en avait un.
Pour supporter la chaleur du four, même en hiver, il s'habillait comme en plein été. Quand dans la pharmacie elle se pencha en avant en appuyant ses coudes sur le comptoir, la blouse montra tout son contenu. En d'autres temps, cette vision aurait rendu la journée du pharmacien heureuse et fourni le point de départ de longues et épuisantes méditations. Maintenant l'intérêt, bien qu'encore un peu éveillé, s'est perdu dans mille flots de mémoire et, qui sait pourquoi, les bombes à la crème me sont venues à l'esprit : pas celles frites, celles cuites au four. En tant que lycéen, il en était fou. Alors, alors qu'il réfléchissait au métier de pâtissier, qu'il imaginait les mains sur la pâte, le boulanger lui raconta que l'oncle Glauco, du balcon, en plus de commander du pain, l'informa qu'il n'avait plus d'aspirine. Il faut préciser que Glauco, le buraliste, était devenu précoce pour tout le monde ZJe Glaucus: son surnom, dû au fait que les enfants du Borgo l'appelaient ainsi lorsqu'ils jouaient avec ses deux vrais petits-enfants. Il était au lit avec de la fièvre. Giovanni, le pharmacien, son neveu naturel, savait qu'il avait aussi téléphoné pour bavarder, raconter, inventer des histoires, comme il le faisait cinquante ans plus tôt, lorsqu'il rentrait de Rome le samedi soir.
Fermant la pharmacie, les mains dans les poches à cause du froid, notre héros partit chez son oncle. Il suffisait de descendre un peu plus d'une centaine de mètres et l'on arrivait au Borgo : une petite place fermée en cercle par de robustes maisons de style patriarcal, habitées surtout par des paysans qui avaient des terres à proximité. Le pharmacien est né dans une de ces maisons. Il s'était installé dans la partie haute du village avec sa mère et Umberto, son frère cadet, lorsqu'il avait neuf ans : l'année de la mort de son père. Et dans cette grande maison, il ne restait que son oncle : l'oncle Glauco.
À cette époque, il traversait souvent la place du Borgo, car, en plus de son oncle, il rendait visite à Antonio, l'un de ses plus proches amis d'enfance, enfermé chez lui depuis plus d'un an parce qu'il était malade.
Noël était proche. Les lumières brûlaient déjà depuis quelques heures. Ils auraient dû indiquer une acclamation qu'il n'a pas ressentie. Autrefois ces lumières lui donnaient de la joie et de la mélancolie, maintenant il les sentait hostiles, comme si elles avaient du mal à brûler pour lui aussi, et sous ces ampoules festives il se sentait comme un intrus.
Sa philosophie sur l'être humain était simple : le monde sourit aux belles personnes, et fait des grimaces aux moches qui, pour ne pas succomber, développent le talent de la sympathie. Lorsque vous êtes avec eux, vous obtenez une bonne humeur; ils sont toujours gais et prêts à rire. Les gens laids savent raconter des blagues ; la belle ne le fait pas, car elle n'a jamais eu besoin de le faire.
Il n'appartenait ni au beau ni au laid, car il était insignifiant. Pour survivre, il avait construit un monde parallèle dans son esprit. Dans cette dimension différente, il tombait souvent amoureux de ses clients. Il les préférait mariées, mélancoliques et souffrantes, car il aimait à croire que leurs maris les négligeaient, voire les battaient, mais surtout qu'elles n'appréciaient pas la douceur de leur peau, le son de leur voix et de leur cou. Oui le cou, pour le pharmacien un lieu de perdition, où se concentrait toute la féminité d'une femme. Le soir, avant de s'endormir, il passait en revue les plus belles femmes du village, et les imaginait en train de ranger, nettoyer, repasser, raccommoder et, après le dîner, avec l'expression d'un condamné se dirigeant vers la potence, se couchant avec son mari. Ainsi passait-il ses journées. Ainsi s'était écoulée sa vie.
Il descendit la pente de Tarcisio puis tourna au coin, après avoir dit au revoir à la femme de Tullio qui arrosait les géraniums du balcon.
***
Il est arrivé à la maison de l'oncle Glauco, où il est né, où a été conservée sa vie d'enfant : celle passée au Borgo, quand son père était encore en vie ; quand la timidité ne l'avait pas encore saisi, quand il était encore capable de courir pour libérer sa joie de vivre.
Dans cette maison, personne n'entrait par la porte. Il y avait une porte latérale toujours ouverte, d'où, par un chemin à quelques mètres de là, on entrait dans la cour arrière, et de là on entrait dans la maison par la porte de la cuisine, qui n'était jamais fermée à clé. La cour était bordée tout autour par un muret qui, avec le mur de la maison, formait un rectangle. Au-delà du muret, des sapins verts enfermaient cet espace et l'isolaient du monde. C'est là que se déroulait autrefois la vie estivale de sa famille.
Désormais, seul l'oncle Glauco y vivait, fidèle gardien de la maison et de ses souvenirs. De l'autre côté de l'allée donnant sur la cour, invisible de la place Borgo car cachée par la maison, le muret a été interrompu pour donner accès à une petite clairière entourée d'un groupe d'arbres en cercle. C'étaient des acacias. Parmi ceux-ci se trouvent quelques cerisiers. Cela vous a fait penser à une faveur de mariage. L'oncle Glauco l'avait appelé Le jardin des cerisiers en l'honneur de Tchekhov. Quand il en a parlé, il l'a indiqué comme la poésie et jamais comment Écrivain. Des pique-niques y étaient organisés, enfant, Giovanni, son frère et la nuée de leurs amis du Borgo avaient installé le quartier général principal pour jouer à cache-cache et prendre les décisions les plus importantes pour leur malice. Là, ils ont célébré les anniversaires, les jours de fête et tous les saints qui, dans le calendrier, se sont produits les dimanches et les jours ensoleillés.
Parfois, le soir, en partant, après avoir rendu visite à son oncle, dans l'obscurité, Giovanni entrait dans la cerisaie. Il resta là immobile, en silence. Les plantes fleuries sentaient intensément, comme bien des années auparavant, à tel point qu'il semblait entendre les cris d'amis qui jouaient avec lui quand il était enfant. Il a chassé les rumeurs. Parmi ceux-ci, il a également reconnu le sien, ce qui lui a causé une douleur très profonde, comme pour un ami cher décédé.
Giovanni monta dans la chambre de son oncle sans frapper ni allumer la lumière. Il aurait pu marcher même les yeux fermés. Et les yeux fermés, il aurait pu reconnaître l'odeur de cette maison. Il était convaincu que la combinaison des diverses odeurs des épices utilisées pour cuisiner, mêlées à l'odeur de ceux qui y vivent, constituait une sorte de carte d'identité : l'haleine, l'après-rasage, le dentifrice, la chromatine utilisée pour cirer les chaussures et la marque de cigarettes fumées. Il était sûr que dans cette odeur unique, identifiable, se cachait le patrimoine génétique de toute la famille qui y vivait, et pas seulement : son histoire aussi, les moments terribles et les rares moments de bonheur qui traversent aussi la vie de chacun.
En entrant dans son ancienne maison, il aimait retrouver la même odeur.
L'oncle Glauco lisait un recueil de poèmes. Dès qu'il eut connaissance de la visite, il la clôtura et, comme s'il poursuivait un dialogue entamé pendant des heures :
«Chaque poème a son centre de gravité. "Enfant" est le centre de gravité de samedi du village. "Profite, mon enfant, doux état …” La poésie s'accroche à ce mot, comme une robe accrochée à un clou. Si vous enlevez le clou, tout s'effondre. Puis, regardant la chaise : « Vous êtes pressé ? Vas-tu à Antonio?».
« Oui », répondit le neveu en s'asseyant sur le lit et en serrant le cou-de-pied de son oncle à travers les couvertures.
"Le docteur m'a dit qu'il ne verrait pas la nouvelle année."
« Il me l'a dit aussi », et au bout d'un moment : « Comment vas-tu ? ». Ce n'est qu'avec son oncle et ses amis proches, Antonio et Pasqualino, qu'il a pu se débarrasser de la timidité et de cet air maladroit qui le rendait différent des autres. Une diversité à laquelle il ne pouvait échapper. Comme un bégaiement qui surgit non désiré, inexorable.
"Juste un peu de fièvre."
"Demain, vous serez debout." Giovanni commença à se lever lentement, comme un vieillard plein de rhumatismes. Il posa la boîte d'aspirine sur la table de chevet. Puis, quand il est arrivé à la porte, il a ajouté : « A bientôt.
L'oncle Glauco remonta les couvertures jusqu'au menton : « Tu sais, mourir d'une fièvre ou d'un bouton infecté, c'est humiliant.
Giovanni resta debout, appuyé d'une main sur le battant de la porte ouverte, sans parler. Cela lui sembla un de ces moments où l'oncle Glauco commença à créer des fables, des histoires, des rêves. Mais cette fois, il a juste ajouté :
"Cette fièvre n'est pas pour moi."
"Non?"
"Non. J'aimerais mourir… au milieu d'une fusillade. Et il éclata de rire.
« Ou comme Leslie Howard dans le Forêt pétrifiée?!"
"Oui bien."
"Au revoir," ajouta Giovanni au bout d'un moment.
« Il y a une chose que je ne peux pas accepter à propos de la mort. J'en parlais avec Antonio."
"Qu'est-ce?"
« Ça, je ne peux pas le dire. Un accident si important, et vous ne pouvez pas en parler ! Ils sont restés silencieux pendant un moment."
"Demain je passerai."
"Dites bonjour au Pitteur".
***
Le Peintre était le surnom d'Antonio. Il vivait avec sa femme dans la maison voisine de celle de l'oncle Glauco. Il avait le même âge et, avec Pasqualino, connu comme le philosophe, un ami proche du pharmacien. Quand ils étaient enfants, ils aimaient faire pipi sur le mur blanc entourant la maison de l'oncle Glauco. Antonio était le meilleur. Il était capable de dessiner un cercle parfait. D'où le surnom. Ils allaient à la fontaine boire pour se remplir d'eau. Après une demi-heure, ils étaient prêts à peindre à nouveau.
Puis ils avaient grandi. Lorsqu'une fille traversait la Piazza del Borgo, les jeunes hommes se sentaient en droit de faire un commentaire. Et des phrases codées telles que "des roseaux dans le vent" venaient rejeter une fille trop maigre, ou "cul qui danse", "du lait pour tout le monde" etc. Au contraire, Antonio, qui travaillait déjà dans la boucherie de son père, utilisait des termes appartenant à une catégorie sémantique différente. Pendant ce temps, d'une fille, il savait indiquer le poids et le nombre de steaks qu'il aurait pu obtenir à partir des côtes. Et après avoir évalué la fermeté des reins, quand des éloges étaient nécessaires, le commentaire était : « Marchez comme un mouton avant de tondre ».
C'est Dora, la femme d'Antonio, qui a ouvert la porte. Avec le pharmacien, il y avait cette entente tacite qui vient du fait d'avoir été de petits camarades de jeux. Il l'accompagna jusqu'à la chambre sans dire un mot. Antonio se tenait à la fenêtre. Il regarda le carré en gardant son front contre la vitre. Giovanni s'est approché et s'est arrêté pour regarder aussi la Piazza del Borgo. Antonio, sans se retourner : « Vous voyez ces femmes ? Même après ma mort, ils continueront d'aller à la fontaine pour remplir le bassin. Alors elles la balanceront sur sa tête, et droites, comme les reines Vatusse, elles rentreront dans la chaleur de leur foyer. La vie sera la même, toujours. C'est ce qui compte." A ce moment, Alberto passa. Il avait travaillé la terre toute sa vie, un vrai fermier, et maintenant, dans sa vieillesse, il a gratté quelque chose comme cordonnier. Antonio ajouta d'un ton émerveillé : « Et puis je ressens une sorte d'affection passionnée, une pitié pour tout le monde. Même pour ce connard d'Alberto. On ne s'est pas parlé depuis qu'il voulait me vendre cette chèvre estropiée. Souvenirs? Mais qui sait si je lui faisais l'arnaque parce que je le voulais pour rien. Bref, maintenant j'embrasserais ce connard. Toujours avec le visage d'un martyr. Pourtant je l'aime. J'ai pitié de sa vieillesse, de l'amour silencieux et réservé dont il assiste sa femme. Il la garde comme une reine, cette demi-sorcière. Mais je l'embrasserais aussi. Cette sorcière avec la moustache!». Puis, lentement, il revint au fauteuil à côté du lit, ajoutant avec un soupir : « Pour que le monde marche bien, nous devrions tous être sur le point de mourir. Il ramassa la grille de mots croisés et, comme s'il lisait : « Oncle Glauco ? ».
« Il va bien », répondit Giovanni en s'asseyant en face de lui sur le fameux fauteuil galeux, aux ressorts cassés mais très confortables. Il croisa ses jambes et croisa ses doigts derrière sa nuque. Puis il a ajouté : "Comment te sens-tu aujourd'hui ?"
"Bien. Un peu mieux." Puis, après un soupir, pointant ses coudes sur les accoudoirs pour se redresser et avancer, à voix basse : « Je dois te parler de quelque chose qui va te paraître étrange, peut-être fou, mais c'est très important pour moi.. .que je suis en train de mourir. Pardonnez-moi si je vous parle grossièrement, mais je ne peux pas être approximatif, tout doit être clair".
Giovanni se pencha également en avant. Antonio, à voix basse, pour empêcher Dora d'entendre, poursuivit entre mille pauses gênées : « L'idée de mourir est devenue une obsession. J'ai hâte de m'en débarrasser. Oui, j'ai peur, mais je dis… il y a des milliers de personnes qui meurent chaque jour. Si les autres peuvent le faire, moi aussi… Mais ce n'est pas de ça dont je veux te parler… Je ne sais pas par où commencer… C'est de Dora… Tu sais comment ça se passe, au bout d'un moment tu l'épouses tout devient une habitude. Et ta femme ne la traite plus comme une reine… mais comme une servante. Bref, j'ai plein de remords. Tu as eu raison de ne pas te marier..."
"Je ne me suis pas mariée parce que je n'en ai pas pu."
« Tais-toi, dis plutôt que tu n'as jamais voulu m'écouter. Mais maintenant, laissez-moi vous dire, avant que Dora n'entre… L'autre soir, j'ai eu une douleur insupportable. Il ne m'a pas laissé seul un instant. Elle est si chère, aimante. Mais tu le sais… Bref, en mai dernier, j'étais déjà malade, je lui ai fait apporter un bouquet de fleurs : c'était son anniversaire. J'ai écrit une phrase d'amour sur le mot... sans signer... J'ai pensé qu'il serait plus amusant d'éveiller la curiosité, puis de lui dire la vérité... Anna, la femme du maréchal, était dans la cuisine quand elle l'a reçu . Il ne se confie qu'à elle. Bref, pour l'amant mystérieux, tout le monde pensait à eux sauf moi. J'ai tout ressenti. Anna a fantasmé et a mis le maire, la garde municipale sur la liste des prétendants possibles et puis ils ont beaucoup rigolé en ajoutant le curé à la liste. À ces rires, je me sentais tellement étranger. Et j'ai tout de suite compris que si Dora avait su que je lui avais envoyé les fleurs, cela aurait été comme lui offrir des chrysanthèmes. Je ne l'ai pas entendue aussi amusée depuis des années. Je ne fais plus partie de ce monde. Et c'est normal. Très normal… Nous n'avions pas d'enfants. La seule chose qui me console, c'est qu'au moins il a cet ami. Toi aussi, après, essaie de la voir, ne la laisse pas seule comme un chien."
"Donc? Tu es jaloux?"
« Non, non, tu ne comprends rien, putain ! Je ne suis pas jaloux. Je meurs, pour moi il n'y a plus de telles bêtises." Épuisé, il se renversa sur sa chaise.
"Je ne peux même pas parler."
"Je ne comprends pas ce que tu veux me dire."
« Je veux vous dire qu'il y avait dans les réponses de ma femme ce plaisir subtil et timide de la flatterie.
"Alors tu es jaloux !"
"Non mon ami. Sois sérieux. Je n'ai personne d'autre à qui demander cette faveur. Sois sérieux!"
"Une faveur?!"
"Oui, une faveur," et il se pencha à nouveau sur ses coudes. « Je veux vous laisser avec cette flatterie. Je veux au moins avoir ça de moi. Je n'ai rien d'autre à te donner." Et il se laissa retomber sur la chaise. Après un moment de silence, comme pour donner à l'amie le temps de réfléchir et de comprendre : « Tu dois lui envoyer un bouquet de fleurs à chaque anniversaire. Le prochain aura lieu le 28 mai. Je ne serai certainement pas là. Tu as besoin de faire solo ce. Et maintenant je suis désolé, je n'ai plus la force de parler.
Ils ont gardé le silence. Au bout d'un moment, Giovanni se leva et, avec le naturel de celui qui emménage chez soi, se dirigea lentement vers la fenêtre. Pas celle qui donnait sur la place de la fontaine, mais celle d'où l'on pouvait voir la maison de l'oncle Glauco, toute proche. Antonio a dit: "Pensez-vous au nombre de fois où nous avons peint ce mur?" C'était vrai, et Giovanni hocha la tête avec un sourire. Puis elle s'approcha de lui. Antonio, les yeux fermés, haletait, comme s'il venait de terminer une longue course. Il était affaissé ; tête légèrement inclinée d'un côté. Giovanni toucha sa joue du revers de la main et dit : « Aujourd'hui tu ne t'es pas rasé », puis : « A demain ». Antonio, toujours les yeux fermés, immobile : « Tu l'as oublié ? » Giovanni répondit par un simple aucuneet a quitté la pièce.
Dora, assise à la table de la cuisine, épluchait les pommes de terre. Elle était encore belle. Pas très différent de quand, au lycée, il a remporté les compétitions de saut en longueur. Elle n'était pas grande mais, si mince, elle en avait l'air. Le visage ovale conservait encore sa grâce, peut-être à cause du petit nez de ce visage blanc, aussi lumineux que le vert de ses yeux. Noué derrière la nuque, un mouchoir bleu pâle retenait ses cheveux gris froncés. Il portait toujours une salopette à bretelles. De loin, il ressemblait à un ouvrier. Un métallurgiste. Mais de près c'était un plaisir de voir à quel point cet uniforme masculin contrastait avec la féminité de son long cou élégant et son sourire économe, mais toujours franc et hospitalier. Ses manières délicates, majestueuses et composées avaient quelque chose de modeste qui transparaissait également dans sa voix. Ce dos toujours droit, comme celui d'un athlète, lui donnait une présence sérieuse, presque austère, même dans des moments comme celui-ci : s'asseoir pour éplucher des pommes de terre.
Elle se leva aussitôt, comme si on l'avait surprise en train de faire quelque chose d'interdit. Il s'essuya les mains sur le torchon qui était sur la table et, sans parler, se dirigea vers la porte. Giovanni sortit en retournant le sourire que Dora venait d'amorcer en gardant la porte ouverte et en regardant le sol. C'était de très peu de mots. N'importe qui, ne la connaissant pas, l'aurait prise pour sourde-muette.
Il faisait froid et humide dehors. Giovanni se tourna pour regarder la façade de la maison d'Antonio. Il pensait que bientôt ils colleraient l'affiche de sa mort. Il imaginait quand ils mettraient les leurs. Pas plus de cinq ou six personnes se rendraient aux funérailles. Toute cette souffrance et cet amour, tous les souvenirs seraient perdus. Dans le village il était le seul à ne pas avoir de surnom car c'était un homme opaque, aux contours imprécis, il était invisible, inexistant. Parfois, il pensait qu'il l'était déjà, mort. En remontant la rue de Tullio, il réfléchissait à tout cela et il lui semblait que la vie l'avait oublié.
L'oncle Glauco se rendait au moins une fois par jour chez Antonio, qui seul parlait ouvertement de sa mort imminente comme s'il s'agissait de l'intrigue d'un film. Entre autres choses, ils ont convenu qu'après les funérailles, le soir même, l'oncle Glauco devrait garder une bougie allumée près de la fenêtre. Antonio l'éteindrait trois fois de suite. Une salutation, un signe que la vie continue là-bas.
Ils se sont rencontrés d'autres soirs. Dans l'un des derniers Giovanni est allé avec l'oncle Glauco et Pasqualino, le philosophe. Il n'y eut pas de silence gênant cette fois. Antonio était excité. Il parlait toujours. Il se souvint un à un des contes romains de l'oncle Glauco. Il les a reçus d'occasion d'Umberto, le frère cadet de Giovanni. Il se souvenait des premiers amours nés autour de la fontaine de la place Borgo. Autour d'elle, l'histoire avec sa femme avait commencé.
Alors qu'ils sortaient, il prit le bras de l'oncle Glauco et lui dit: «Je recommande la bougie!». Et il éclata d'un rire franc. Dès qu'il fut dehors, Pasqualino commenta: "Est-ce que ce serait une bonne chose qu'il y ait une vie après la mort?"
"Il y en a qui marchent dans la rue mais qui sont déjà morts" répondit Giovanni.
Ils se sont dit au revoir, et chacun a pris une direction différente. Le pharmacien savait qu'une fois rentré chez lui, et qu'il aurait ouvert la porte d'entrée, il sentirait cette odeur de couture, d'antan, des vêtements rangés dans les armoires à mouler.
***
Le printemps est arrivé. Antonio avait été enterré dans la chapelle familiale fin janvier.
Dora avant de s'endormir regarda la bougie allumée dans la maison de l'oncle Glauco. Derrière la fenêtre, il lui sembla qu'il lui faisait une sorte de salut. Mais le temps a passé et le désir de se détacher des souvenirs de la maladie de son mari a commencé à pénétrer son cœur, avant même son esprit.
Giovanni a tenu sa promesse : il a envoyé des fleurs à Dora pour son anniversaire. Et cela, également grâce au vent printanier, a réactivé l'imagination rouillée de Dora, mais surtout a enflammé celle d'Anna, qui a commencé à fermenter et à extraire les hypothèses les plus absurdes, comme du chapeau d'un magicien.
Un soir, après avoir été chez l'oncle Glauco, Giovanni s'arrêta chez Dora pour livrer des médicaments. Son visage était rouge de fièvre. Avant de partir, immobile devant la porte pendant qu'il lui donnait un dernier conseil, il songea que Dora n'avait pas prononcé un seul mot depuis qu'il était entré. Il lui a conseillé de mieux se couvrir car la température avait baissé. Puis il arriva qu'elle, toujours sans parler, prit un chandail posé sur une chaise à proximité, et l'enfila devant lui. Il était en laine, havane clair, et peut-être avait-il rétréci à cause du lavage continu. Alors Dora, accompagnant les mouvements de drôles de grimaces pour les efforts, a d'abord mis la tête dedans, puis les bras tendus vers le haut. Pendant quelques secondes, le pull resta serré et retroussé comme un beignet, sous les aisselles et sur la poitrine qui, ainsi étranglée, mettait en valeur toute sa consistance solide et abondante. Puis il a finalement baissé l'ourlet du pull qui la couvrait jusqu'aux hanches.
Ce numéro de gymnastique artistique fit exhaler dans le corps de Dora une odeur pleine et forte de femme qui frappa notre héros, faisant fondre dans ses veines une joie anxieuse.
Le pharmacien sortit avec une grande envie de siffler. Il était satisfait, mais il ne savait pas quoi. Lentement, prudemment, de peur que l'ambiance ne se dégrade, il remonta la pente. Depuis les maisons du Borgo, comme une brume magique, l'odeur de la viande sautée flottait sur la place.
À partir de ce jour, Giovanni a commencé à visiter plus souvent la maison de Dora. qui l'a accueilli sans dire un mot, mais avec un sourire bienveillant et fraternel. Les quelques fois où il a parlé, c'était comme mettre du baume sur une plaie. Ses phrases parvenaient aux oreilles du pharmacien sous forme de chanson, avec la douceur enchanteresse de l'hypnotiseur. Ses discours rares et brefs lui semblaient maintenant, débordant de profondes significations qui cachaient des sentiments élevés pas clairement exprimés par pudeur ou pour qui sait quelles autres nobles raisons. Maintenant, tout en elle, même un éternuement, était un éclat de grâce enchanteresse. Il l'a amusée en racontant comment certains de ses clients ont mutilé les noms des médicaments. Et même un avait avalé des suppositoires en les croyant être des pilules et à la pharmacie il s'était plaint de leur amertume.
Il avait toujours bien fait dans le rôle de l'ami des dames. Son apparence, qui n'avait rien de masculin et rien de féminin, les rassurait, les affranchissait de toute forme de concurrence.
Ils ont aussi parlé du bouquet. Dora sourit gênée et avoua qu'elle avait peur que ce soit le geste d'un dangereux fou. Notre pharmacien était satisfait de ce rapport. Il aimait s'asseoir dans cette cuisine, respirer l'odeur de la maison et regarder les murs de chaque côté de la cheminée, suspendus à des couronnes de poivrons secs, comme des amulettes d'une ancienne civilisation. Il a compris que ses visites, même si elles n'étaient pas nécessaires, étaient les bienvenues. Cela ne le dérangeait pas de les comparer, à lui-même, à l'effet placebo d'une drogue inutile.
Un soir, c'était encore le printemps, le pharmacien, revenant de l'oncle Glauco, rencontra Dora qui tenait un panier de linge mouillé à suspendre devant la maison. Puis il s'aventura dans un geste spontané qui le surprit : il lui toucha la main et lui demanda : « Comment vas-tu ? En prononçant ces deux mots, une anxiété éclata en lui qui le fit vaciller. Elle n'a pas répondu. Ses lèvres se retroussèrent légèrement sur le côté. C'était un sourire. Puis il inclina légèrement la tête, comme pour dire "je reçois par ». Le cœur dans la gorge, Giovanni repartait lorsqu'elle parla et dit : « Tu viens demain ? Je prépare les poivrons farcis». Cette fois, c'est lui qui répondit par l'affirmative avec un sourire : il était incapable de parler. Il avait cru entendre là-dedans « tu viens demain ? un souffle complice, plein de sous-entendus.
Au lieu de remonter à la maison, il s'engagea dans l'allée de l'oncle Glauco et pénétra directement dans la cerisaie. L'odeur des acacias était si intense qu'elle donnait le vertige. L'air était chaud. Un chemin bordé d'arbres partait du jardin, utilisé uniquement par ceux qui étaient à la maison. Plus bas, il était relié à une petite route qui descendait vers le "fossato": un ruisseau actif uniquement en hiver. En été, il se réduisait à de petits étangs peuplés de têtards et de grillons chanteurs.
L'épaisse obscurité fournissait à l'esprit de Giovanni les images dont il aimait se souvenir. Avant d'atteindre la route, à mi-chemin du chemin, la végétation s'épaississait et il y avait un tronçon où les branches des arbres qui longeaient les flancs s'entrelaçaient au sommet pour former une sorte de voûte. C'était comme traverser un tunnel. Ils l'appelaient "grotte". Giovanni, dans l'obscurité, la revoyait telle qu'elle était au printemps : des grappes de campanules blanches et violettes flanquaient le début du chemin qui menait à la route. Plus bas, des tapis de primevères, de cyclamens et de marguerites ajoutent de la couleur. Entrer dans cette avenue, c'était comme entrer dans le tableau d'un peintre impressionniste. L'été, quand il faisait étouffant, il faisait frais dans la grotte. Le bruissement des feuilles sèches de l'année précédente sous vos chaussures, le bourdonnement assourdissant et hypnotique, mêlé au gazouillis des milliers d'oiseaux qui y ont fait leur nid, en ont fait un lieu enchanté, où les garçons du Borgo ont libéré leur imagination pour jouer histoires intérieures hors de ce monde. Quand on voulait faire quelque chose de transgressif, on allait à la « grotte » : la transgression consistait à grimper aux arbres. Ce qui était strictement interdit. Ils sont allés mettre du pain mouillé dans les nids : chacun avait le sien à s'occuper. C'est là que, un peu moins de cinquante ans plus tôt, Giovanni avait embrassé Dora sur la joue, comme ça, tout d'un coup. Peut-être n'avait-elle même pas remarqué. Il y avait pensé pendant des années.
Les visites de John ont continué. Dora a montré du plaisir à les recevoir, mais rien de plus.
L'hiver est arrivé. Un jour, le maréchal, invité à dîner avec sa femme Anna, se rend chez Dora après sa promenade du soir. Il était rarement vu autour. Grand, mince et droit comme un fuseau, il avait gardé la belle mine d'un vieux qui reste jeune. Avec les gens, il avait gardé le ton sérieux et sage qu'il avait lorsqu'il était de service. Mais il était capable de sourire et de dire quelques mots sans importance, de temps en temps. Sa femme Anna était là depuis le début de l'après-midi. Les pourparlers tournaient autour de la collecte de fonds pour le nouveau clocher de l'église. Les comptes ne correspondaient pas. Parson triche ? C'était le sujet de prédilection d'Anna qui, entre autres, insistait sur le fait que c'était lui, le curé, qui avait envoyé les fleurs. Le visage de Dora alternait des sourires incertains de tolérance courtoise et résignée : elle respectait le curé, Anna le haïssait, comme son père, le notaire, qui à son tour était haï et craint de toute la ville, le haïssait.
Lorsque le maréchal entra, les lentilles bouillaient déjà depuis un certain temps dans le chaudron suspendu au crochet de la cheminée. Dora, sur la pointe des pieds, avait l'intention d'essayer d'obtenir le sac de sel de l'étagère du haut du buffet, elle ne pouvait que le toucher du bout des doigts, le poussant de plus en plus à l'intérieur. Le maréchal vint à son secours par cavalerie, s'allongea derrière elle et prit le sac de sel. Cette agitation créa un profond trouble dans l'âme fragile et sans défense de Dora : un instant le maréchal, sans aucune intention, avait touché le bas du dos de Dora. Ce n'était qu'un instant, mais Dora dormit peu cette nuit-là, incertaine si le maréchal avait péché innocemment ou avec préméditation. Et toute la soirée, elle ne l'a jamais regardé, et ses joues sont restées roses, comme lorsqu'elle faisait des compétitions au collège.
Ainsi, tandis que le nombre de visites de Giovanni augmentait, une turbulence anxieuse grandissait dans la poitrine de Dora à cause de l'épisode avec le maréchal. Il devait en parler à quelqu'un. Et un matin, au milieu du boulanger qui était passé pour l'habituelle livraison de pain, Dora envoya un mot au pharmacien : J'ai découvert qui m'a envoyéaux fleurs. Je t'attendrai ce soir. Giovanni se sent démasqué et, de plus, interprète ce "je t'attends ce soir" comme une déclaration d'amour. L'anxiété l'assaillit. Comment devait-il se comporter ? Ses expériences amoureuses provenaient exclusivement des films que l'oncle Glauco racontait.
Il sortit la veste du placard qui sentait encore un peu la naphtaline.
Il l'avait rangé au printemps. Il mit les mains dans ses poches, et tandis qu'il descendait la rue de Tarcisio, enveloppé de cette chaleur nouvelle, il ressentit une légère euphorie, une disposition renouvelée à l'amitié, à une nouvelle entente avec le monde entier. Ça sentait la lavande. Il était allé chez le barbier qui lui a également coupé les cheveux. Il pensa à son ami Antonio. Il savait qu'il avait son approbation. Lui-même lui avait conseillé de ne pas "la laisser seule comme un chien" : ses mots.
Un parfum rassurant de châtaignes grillées émanait de la maison de Tullio.
En frappant à la porte de Dora, Giovanni craignit que ses oreilles ne s'enflamment. Il a essayé de rejeter la sensation désagréable de se sentir sous l'apparence de l'invité, et non de l'époux. Dora écarta sa chaise pour l'inviter à s'asseoir. Sur la table, évitant de le regarder, elle posa le plateau de neige et l'habituelle bouteille d'Anisette. Tout s'est passé sans le moindre bruit et dans le silence le plus absolu des deux. Elle ne portait pas la salopette de métallurgiste, mais elle avait sur la tête un mouchoir qui la faisait ressembler à une paysanne.
Tout à coup Dora lui dit que c'était le maréchal qui lui avait envoyé les fleurs. Elle en était sûre. Giovanni était essoufflé, avec la moitié de la neige dans la bouche, immobile. Dora continua de parler. Giovanni comprenait un mot sur dix. Il entendit : « C'est incroyable… Le mari de ma meilleure amie… Je n'ai pas le courage de la regarder… » Et pourtant, même étourdi par ce grondement de voyelles et de consonnes qui lui résonnait dans la tête, il voyait très bien ce que se passait ce qu'il avait redouté, et pour cela gardé bien caché dans les couches les plus profondes de son cerveau. Dora n'aurait jamais pu tomber amoureuse de lui. D'autres fois, il avait éprouvé, sous des formes différentes, la même humiliation, la même angoisse. Et comme les autres fois, il aurait aimé se cacher, s'enfuir, pour ne pas laisser cette vilaine histoire l'atteindre.
A la porte, avant de refermer la porte, Dora le supplia de revenir la voir car maintenant plus que jamais elle avait besoin du soutien d'une amie sincère et loyale. Giovanni, seul, au milieu de la place, ne comprenait pas s'il devait monter ou descendre. À ce moment, le visage d'Alfredo, le cordonnier, apparut devant lui, qui le salua en lui prenant les deux mains, presque comme s'il voulait les embrasser, et lui parla en les gardant sur sa poitrine, comme s'il il voulait garder quelque chose à lui. Elle lui raconta l'amitié qu'elle entretenait avec son père, qu'elle bénit d'avoir engendré un fils aussi bon et intelligent. Et enfin, soufflant son haleine cipollino sur son visage, elle lui demanda de jeter un coup d'œil à sa femme qui était malade. Et il le traîna en lui tenant les mains. Giovanni n'a rien compris, il n'a pas parlé, il s'est retrouvé dans la chambre où gisait la femme d'Alfredo, qui semblait morte. A tel point qu'au moment où il ouvrit les yeux, Giovanni sursauta et prit conscience de ce qui l'attendait. Il a rappelé plus tard qu'il avait conseillé de boire du vin bouilli pour la toux et d'avaler immédiatement deux comprimés d'aspirine.
Alfredo lui a montré une photo jaune avec des vers à bois mordant sur les bords. Il était plein de points noirs laissés par les mouches : "Maintenant, nous sommes vieux, avec la peau pendante, mais quand nous étions jeunes, nous étions différents." C'était sa photo de mariage. "Est-ce que tu vois? Ma femme était une fleur. Et je l'ai toujours traitée comme une fleur parce que pour moi, docteur, c'est comme si toutes ces années ne s'étaient pas écoulées. Nous avons eu sept enfants. Tous installés, mais loin. Nous sommes restés seuls. Ce n'est pas important. Nous nous aimons." Et au bout d'un moment : « Alors c'est pas grave ? ».
"Non, vous serez ensemble pendant encore de nombreuses années."
« Béni soit ta mère qui t'a enfanté. Béni sois-tu." Et lui baisa les mains.
Il a quitté cette maison plus conscient de ce qui s'est passé dans la maison de Dora. Il était épuisé, à peine capable de marcher. Mais il était déjà rentré dans sa vie, avec laquelle, bien qu'infernale, il était plus familier.
Il s'approcha de la fontaine. Du centre de la place, on pouvait voir les cuisines : le cœur de chaque maison. C'était l'heure du dîner. Au-delà des rideaux des fenêtres éclairées, des ombres anonymes se déplaçaient. C'était les familles. Bruits de vaisselle, de chaises déplacées, voix, éclats de rire : dans ces maisons la vie chantait son chant. Giovanni s'est vu interdire l'accès à ce merveilleux carrousel humain. Il commença à monter, lentement, courbé, comme s'il portait sur ses épaules tout le poids de l'inutilité de son existence. Il se tourna pour regarder la place. C'est là qu'enfant, il avait joué au docteur, à la marelle, à cache-cache et à se pourchasser tout le temps. Pour les garçons du Borgo, se pourchasser était un mouvement perpétuel. À cette époque, le Borgo était toujours en fête, plein de vie. L'été, en fin d'après-midi, quand le soleil avait cessé de brûler, en même temps que les jeux des enfants, commençait le va-et-vient des poules, canards et autres animaux. de la maison, qui faisaient la navette entre les écuries et les maisons, errant sans but, comme des touristes distraits et indécis dans une rue grouillante de la ville, inondant la place pavée, dans la lumière violette du soir. Puis, à la tombée de la nuit, comme dans un village féerique, la pâle lueur d'une lampe à carbure apparut des fenêtres, témoignant d'une vie frugale et intime. Le cœur du Borgo était sa place, qui lui paraissait plus grande, plus vaste et plus magnifique quand il était petit. La vie du Borgo gravitait autour de la fontaine. Tandis qu'il attendait que le bassin cuivré se remplisse d'eau, les nouvelles les plus banales de la ville se traduisaient en commérages colorés, et l'amant pouvait échanger des paroles furtives et coupées avec sa bien-aimée, qui entre-temps à la maison avait vidé le bassin pour aller chercher l'eau, l'excuse pour retourner à la fontaine.
Notre héros soupira. Il n'avait plus de force. Il s'assit sur le rebord d'une fenêtre fermée au rez-de-chaussée. Dans la maison de Tullio, quelqu'un racontait une histoire pleine d'esprit. Avant de continuer à grimper, il se retourna une fois de plus. Ses yeux virent tous ses camarades de jeu, un à un, gambader autour de la fontaine. « Le bonheur t'appartient tant que tu veux courir », pensait-il.
Et il crut revoir aussi une boule de chiffon qui, déboulant autour de la place, emportait avec elle des nuées d'enfants poussant des cris hystériques, comme des nuées d'hirondelles au printemps.
. . .
Jean Bucci (Alanno, 1944) est un photographe de rue qui a fait sienne la phrase de Willy Ronis : « Je n'ai jamais continué l'insolite, le jamais vu, l'extraordinaire, mais bien ce qu'il ya de plus typique dansnotre existence quotidienne, dans quelque lieu que je me trouve… Quêtesincère et passionnée des modestes beautés de la vie ordinaire ». Bucci est l'auteur de trois livres de photographie et écrit pour le théâtre. Parmi ses textes de fiction Le train pour Yelets (2010) et Achetez aussi des oignons (2019).