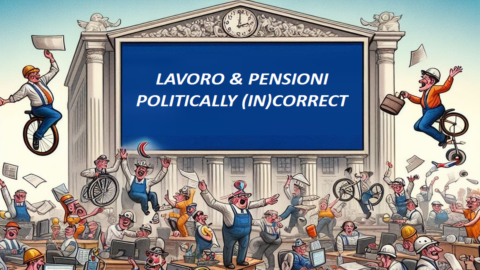Pourquoi les États-Unis ont-ils tiré la sonnette d'alarme sur la crise européenne ? La pression dure depuis l'automne dernier avec un crescendo culminant avec le rude face-à-face du G7 financier. Et hier, le président américain a repris ses fonctions. L'explication la plus évidente est que Barack Obama craint de ne pas être réélu en novembre prochain. Le risque est élevé, Romney se consolide et sans une reprise robuste, les électeurs sont beaucoup plus susceptibles de vouloir changer de toute façon. Après tout, c'est le climat qui souffle dans tous les pays, l'Amérique n'y est certainement pas épargnée. Au contraire. Les gens ordinaires sont convaincus que les États-Unis sont toujours en récession, malgré le fait que le produit brut a augmenté sans interruption depuis 2010. Mais une croissance asphyxiée par les étoiles et rayures, un chômage qui reste élevé, des familles qui peinent à réduire leurs dettes, la marché du logement à l'arrêt, tout cela transforme les chiffres officiels en une illusion statistique.
En conséquence, les États-Unis ne sont plus en mesure d'agir comme une locomotive pour l'économie. L'espoir qu'il pourrait s'agir de la Chine s'est évanoui à mesure que l'usine mondiale ralentit. Dans une certaine mesure, il est bon pour réduire l'inflation intérieure et dégonfler la bulle immobilière avant qu'elle n'éclate. Mais l'impact sur la demande internationale est négatif. Il appartiendrait donc à l'Europe de prendre le flambeau en main, mais dans ces conditions l'UE est un lest.
Dans le nouveau paradigme de l'après-guerre froide, la sécurité économique est une question de sécurité nationale pour les Américains. L'Institute for Strategic Studies l'explique très bien dans une recherche organisée par Sheila R. Ronis qui dirige le projet de réforme de la sécurité nationale mandaté par le Congrès. Bill Clinton il l'a mis en noir et blanc. Avec Robert Rubin, "le Cavour de la mondialisation" comme l'appelle John Morton, set i trois principes directeurs : les États-Unis devaient fonctionner comme animateur, le relais d'un marché mondial unique e maintenir la paix et la stabilité afin de permettre le bon fonctionnement du système multilatéral des échanges commerciaux et financiers. Rubin a travaillé avec Larry Summers et Tim Geithner. Mais le banquier central, Alan Greenspan, partageait également la même approche et pour faire mieux fonctionner le mécanisme, il avait conseillé au jeune président de redresser les finances publiques et de ramener le budget à l'équilibre. George W. Bush est également resté fidèle à cette doctrine, tout comme Barack Obama, d'autant plus après la nouvelle alliance avec Clinton.
Au lendemain du 11 septembre, la grande crainte était qu'une attaque financière ne se déclenche et ne fasse tomber Wall Street. D'où l'ordre d'imprimer de l'argent à une vitesse vertigineuse. Il le raconte Greenspan dans son autobiographie et c'est là que réside la racine des "erreurs" de politique monétaire commises dans les années suivantes : personne n'avait envie de dégonfler la grosse bulle à ce moment-là. Dans l'équilibre économico-politique de cette nouvelle décennie, il est désormais clair que les zones d'importance stratégique primordiale entourent deux mers : la Méditerranée et la mer de Chine. Pour contrôler ce dernier, les États-Unis s'appuient sur le Japon et, de plus en plus, sur la Corée du Sud et les Philippines (sans compter que le Vietnam devient un pays incontournable dans l'endiguement de l'expansionnisme chinois). Pour la Méditerranée, nous avons besoin de l'Europe. Eh bien, le printemps arabe et la guerre de Libye ont montré que les Européens se déplacent au hasard, tentés par le culte aventureux de l'action directe comme dans le cas de Sarkozy ou par le charme discret du désengagement comme dans le cas de l'Allemagne.
L'OTAN elle-même, à ce stade, est en danger. Alors qu'il paraît alarmant à tout point de vue que les trois piliers de la stabilité militaire en Méditerranée soient fragilisés et livrés à eux-mêmes : l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Par coïncidence, les pays se sont prosternés par la crise et mis au pilori par l'Allemagne. Pour l'Italie, la modernisation des bases militaires est déjà en cours et la décision d'équiper les drones sur le territoire italien de missiles est un message clair (également dans la perspective d'un éventuel conflit avec l'Iran dont personne ne veut, mais dont tout le monde parle). En Grèce, les structures clés sont les ports ciblés par les Chinois pour des raisons économiques et par les Russes pour des raisons stratégico-militaires. Quant à l'Espagne, plus isolée que l'arène moyen-orientale, elle est pourtant indispensable pour contenir la vague sociale et politique maghrébine.
La sécurité et la stabilité sont donc des priorités absolues qui englobent, sans interruption, la politique économique, étrangère et militaire. Les Américains voudraient que la BCE imprime de l'argent, achète des obligations d'État et des banques en difficulté, tandis que les gouvernements alimentent le MES qui devrait démarrer début juillet. Que pourrait inverser les attentes du marché et donner au moins six mois de temps (probablement beaucoup plus) pour que la tragédie grecque soit consommée et attendre que l'Allemagne se rende avec moins d'angoisse et, espérons-le, avec plus de vision, au vote de septembre 2013. En attendant, les Américains les élections auront passé.
Si Obama gagne, le multipolaire, augmentera son pression pour que l'Europe devienne de plus en plus un acteur actif et unifié. Si Romney l'emporte, qui n'est pas un isolationniste, est très pil est probable que les États-Unis agiront de manière plus drastique, récupérant la pleine autonomie du dollar (à la fois envers l'euro et envers le yuan) et en augmentant la mise militaire en faveur d'Israël et contre l'Iran. À ce moment-là, l'Italie devient un porte-avions géant.
Tout cela fait partie du travail diplomatique en amont de la G20 (les 17 et 18 à Guadalajara, Mexique). Il devrait également entrer au sommet européen à la fin du mois. Si la crise n'est pas enfin confrontée à une dimension politique qui n'est pas seulement eurocentrique, il n'y a pas d'issue. C'est dans l'intérêt de l'Italie que cela se produise, Mario Monti s'en rend compte. Et depuis la rencontre de janvier dernier, il a justement mis en lumière le lien entre l'Italie et les États-Unis, parfois terni, jamais desserré et encore une fois solidifié dans cette phase.
Le Premier ministre devrait donc se présenter à Bruxelles avec deux dossiers sous le bras : la crise de la dette à droite et la nouvelle stratégie méditerranéenne à gauche. Presser l'Allemagne sur ce point et défier Berlin de montrer la solidarité d'un allié qui a échoué dans le cas de la Libye et dans la stratégie sur l'immigration clandestine (bien qu'ici le pire camouflet soit venu de France). Tout se tient, une des erreurs analytiques et politiques commises par les Allemands est d'avoir isolé les aspects financiers de la crise, les recouvrant de justifications éthico-idéologiques, tantôt fondées, tantôt victimes de clichés et de préjugés. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une approche globale. Cela impose des responsabilités nouvelles et peut-être encore plus sérieuses aux pays de première ligne. Mais ils ont besoin d'une arrière solide et d'un ravitaillement sûr : comme tout bon commandant le sait, les guerres sont perdues lorsque les avant-gardes sont isolées. Les Américains appellent ça du surmenage, mais Napoléon en a déjà payé le prix. Sans parler d'Hitler.