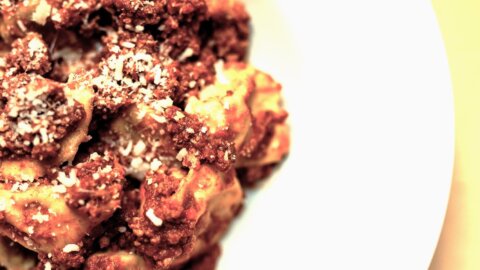La bataille de la dette en cours à Washington n'est pas la comptabilité nationale, c'est la politique et la culture politique : l'idée même de l'Amérique est en jeu. C'est-à-dire si l'Amérique a les moyens de continuer à faire vivre sa promesse d'espoir, ou si elle n'en a pas. Pas dans le sens où il ne les aura plus, mais dans le sens où il doit les reconstruire, une opération qui n'est jamais indolore, et qui sent tellement la vieille Europe. La simple pensée d'être plus ou moins dans une situation européenne irrite profondément presque tous les bons Américains, qui vivent cela comme le reniement de deux siècles d'histoire nationale fière.
Tout d'abord, ne confondez pas la procédure et le fond. Le fait qu'il y ait maintenant une grande négociation, et une grande bataille, à Washington, sur le relèvement du plafond légal de la dette fédérale, qui est maintenant dépassé depuis environ un mois et a été fixé pour la dernière fois à un peu plus de 14 XNUMX milliards de dollars, c'est en partie une question de procédure : la loi impose soit de relever le plafond, soit de réduire les dépenses, sauvagement, et de stopper la dette.
L'ampleur de la dette, qui est et serait de toute façon un problème très sérieux, est la substance, avec ou sans toit. Il y a eu dix augmentations de plafond depuis 2000 et un total de près de 80 depuis 1940, mais la bataille n'a jamais été aussi serrée car, et c'est là le fond du problème, nous avons maintenant atteint les limites du soutenable. En effet, les limites ont été dépassées, mais une comptabilité conforme n'officialise pas tout. Pas encore.
Il est difficile pour Washington de parvenir à un véritable accord à la veille d'une année électorale. Les républicains, dans une sorte d'aveuglement qui ne peut qu'être autodestructeur s'ils ne trouvent pas une personnalité capable de les sauver, sont déterminés à ne pas augmenter les impôts. Comme cela est insensé, les chiffres le montrent et 30 ans, depuis Reagan, de foi idéologique dans les réductions d'impôts comme panacée. La baisse des impôts a stimulé la croissance, sous Kennedy et initialement sous Reagan. Ensuite, ils ont créé d'énormes déséquilibres entre les revenus et les dépenses. Mais l'idée que chaque dollar retiré de Washington est un dollar pour l'Amérique, qui sait comment le rentabiliser magnifiquement, a été pour beaucoup au cœur - pendant 30 ans, pas toujours avant - du credo américain, dans sa version radicale-républicaine. version qui depuis presque deux générations domine dans ce parti.
Barack Obama est prêt à faire des coupes massives dans les dépenses, touchant, jusque-là considérées comme suicidaires, le système public de retraite, la Sécurité sociale. Mais il veut aussi, à juste titre, des augmentations d'impôts. Aujourd'hui, les impôts fédéraux équivalent à 19 % du PIB et avec les impôts étatiques et locaux, nous arrivons à un prélèvement d'un peu moins de 30 % selon les données de 2010 de la Banque centrale européenne. Dans la zone euro, nous sommes à 44 %, globalement.
Un accord sera presque certainement trouvé avant le 2 août, date à laquelle Washington commencerait autrement à ne pas payer les salaires et les factures. Mais gageons que tout sera projeté dans le futur, après 2012, année électorale. Les marchés le croiront s'ils veulent le croire. Après 2012, c'est demain. La culture de la mañana a traversé le Rio Grande.
Les républicains sont affaiblis, au loin, par une foi aveugle dans la bonté de la politique « d'affamer Washington » qui a déjà causé tant de problèmes au pays ; mais une partie importante de leur électorat en cela non seulement les suit, mais les stimule, véritables – aveuglés – héritiers d'une nation née d'une révolte fiscale. L'ennui, c'est qu'une partie des anti-fiscaux est alors favorable à la dépense, quand cela les concerne, comme c'est toujours le cas partout.
Les démocrates d'Obama sont affaiblis, lorsqu'ils offrent des sacrifices à tout le monde, par le fait qu'avec le plan de sauvetage de Wall Street de 2008-2009, et toujours en cours, les sacrifices des grandes banques n'ont demandé que peu.
Quant aux chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Officiellement, la dette publique américaine est de 100% du PIB ou presque, en réalité elle est de 140%, puisqu'il faut ajouter 20% pour la dette étatique et locale, qui est comptabilisée en Europe, et au moins 20% pour la dette des les méga-financiers immobiliers Fannie et Freddie, que Washington garantit intégralement depuis près de trois ans et dont le poids, basé sur un calcul optimiste, n'est pas inférieur à 3 90 milliards. La moyenne des pays de la zone euro est à moins de 120 % de dette. Ensuite, il y a le cas italien à 140%, qui est toujours inférieur aux vrais XNUMX% américains, laissant un instant de côté la "petite" Grèce et le Portugal qui posent aussi tant de problèmes. Deuxième seulement, parmi les pays de l'OCDE, derrière le Japon. L'Italie a beaucoup d'autres problèmes et on ne peut certainement pas dire que globalement elle est mieux lotie que les États-Unis, pas en réalité et encore moins en perspective, mais ce sont les chiffres.
Dans les deux cas, Amérique et Europe, les ressources sont là au final, aussi pénible que soit l'opération. C'est un problème de leadership. Et l'avantage américain, et il y en a d'autres, c'est qu'une seule classe dirigeante à Washington peut montrer la voie. Dans la zone euro, 17 capitales doivent être entendues. Et ce n'est pas une petite complication supplémentaire. Sinon, nous sommes dans le même bateau.
Usa, le vrai enjeu de la bataille d'Obama sur la dette, c'est l'idée même de l'Amérique
par Mario Margiocco - Baisser les impôts et augmenter la dette ou réduire les dépenses et la dette : tout l'aveuglement idéologique des républicains et toute la faiblesse des démocrates se révèlent autour de ce clash - Compromis possible avant le 2 août - La dette publique américaine est officiellement à 60% du PIB mais s'élève en réalité à 140%