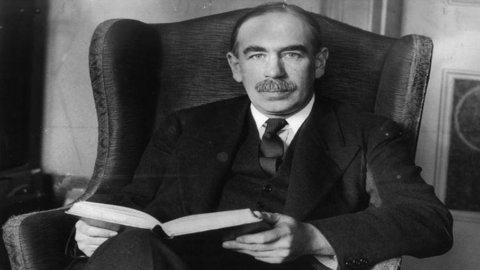Keynes croyait - non sans un attribut un peu perfide pour les continentaux de son île - que Montesquieu était le plus grand économiste français, alors qu'en France il était célébré pour d'autres mérites. Dans l'ensemble, Keynes avait de bonnes raisons. On pourrait être pris dans les intuitions du baron de Secondat et de la Brède sur les maux de l'Italie. A son époque, seules l'Italie et l'Allemagne étaient « divisées en un nombre infini de petits États » avec des gouvernements « martyrs de la souveraineté » des autres. Les grandes nations existantes ont écrasé tout germe de cette souveraineté que les petits États prétendaient exercer sans y parvenir. Tout cela a également eu de lourdes implications en matière économique et pas seulement politique. Les princes italiens étaient divisés par deux en matière de monnaie, de douane, de fiscalité et, en d'autres termes, d'industrie et de prospérité de leurs sujets.
L'ère actuelle de la mondialisation menace de replonger notre économie dans une situation similaire. L'Italie unie avait fait un grand effort pour se libérer d'une condition de servitude envers les puissances étrangères. Ce n'est que lentement que notre pays avait échappé à un destin entièrement marqué par les grandes puissances. La conquête de la souveraineté est passée par un processus de résurgence politique, mais corroborée à la seule condition que les gouvernements nationaux sachent créer un environnement territorial de coexistence civile permettant à chacun de poursuivre, dans la paix, la sécurité et la liberté, et d'atteindre les objectifs de prospérité selon leurs propres qualités d'habileté, d'intelligence et d'assiduité. L'État garantissait cette socialité nécessaire à la valorisation des compétences. L'accession à la souveraineté économique était une condition pour pouvoir mener efficacement des politiques économiques selon les priorités établies par les gouvernements successifs. En termes modernes, le plein emploi, la stabilité monétaire et la prospérité généralisée ne pourraient être convoités et, en grande partie, atteints que s'il était possible de tenir à distance ce qu'on appelle en économie les «contraintes externes» de la balance des paiements avec l'étranger et avec l'étranger. échange. La souveraineté était la condition pour pouvoir vouloir et décider, sinon tout était vain et il ne restait plus qu'à se soumettre.
Connaître les conditions de départ n'est pas d'une faible utilité pour comprendre celles dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Montesquieu nous aide encore en indiquant deux aspects : la masse critique et le degré d'ouverture. Au XVIIIe siècle – nous rappelle-t-il sarcastiquement – certains États de la péninsule comptaient presque moins de sujets que les concubines de certains sultans orientaux. Cela eut des conséquences économiques et donc politiques non négligeables. Les États trop petits pour prétendre à la souveraineté étaient nécessairement « ouverts comme un caravansérail », obligés de recevoir et de lâcher n'importe qui. Dans de tels régimes, la liberté de "passage" était souvent associée à des systèmes politiques oppressifs pour les résidents : des "sociétés ouvertes" dans un seul sens. Pour créer un système-pays, il fallait mettre de l'ordre dans une situation aussi chaotique dans laquelle personne ne pouvait sérieusement souhaiter s'enraciner avec affection et capital. La diaspora des intellectuels italiens était à son apogée à ce moment-là et s'est poursuivie par la suite, avec deux parenthèses pendant les 700-50 premières années après l'unification et dans les premières décennies après la Seconde Guerre mondiale.
Dans le lexique du XVIIIe siècle, ceux qui s'installent sur un territoire, de façon permanente ou temporaire, sont distingués par nation en référence à l'origine, à la langue et aux coutumes. Le pays de type caravansérail, dépourvu de ius loci, se borne à les accueillir. Même les indigènes ne pouvaient pas se sentir chez eux.
En Italie, une certaine masse critique n'a été atteinte qu'après l'unification, mais aujourd'hui la même n'est plus suffisante pour donner une patrie et une souveraineté. Cela s'applique également à l'Allemagne. L'Europe est notre masse critique incontournable pour ne plus nous retrouver dans le caravansérail. Nous avons couru le risque de nous y rabattre, et nous avons vu aussi quelles conséquences peuvent tirer de la politique comme échange de plaisirs et de la loi comme instrument de pouvoir, et nous avons constaté vers quels sujets un chef de gouvernement se prosternait dans ce même façon servile avec les qui exigeaient d'être soignés à domicile. Si un pays veut sortir des satrapies de type oriental et n'accepte pas que ce soit la souveraineté des autres qui décide de son propre destin, il faut aussi reprendre (avec l'Europe) cette tâche ardue qu'est la Patrie, partiellement achevée avec l'Italie. En d'autres termes, il s'agit de construire non seulement une union mais un système de solidarité dans lequel la justice est respectée et rendue, la réputation honorée pour le mérite que chacun démontre et il en va de même pour la juste reconnaissance à accorder à la engagement civil et social qui est le fruit d'une coopération collective continue. Sans la patrie, il y a le caravansérail.
Il y a d'autres risques de retomber dans ce XVIIIe siècle de petits États, emporiums de marchandises et carrefours de marchands, à la merci « des revers et des caprices du destin ». L'Union européenne elle-même, telle qu'elle est, n'aide pas. La protection contre les revers et les caprices du destin, aujourd'hui comme dans la culture d'il y a deux ou trois siècles, se traduit par la protection des et des marchés. Les espaces d'action politique sont là. La protection des marchés est aujourd'hui une nécessité évidente et correspond à la promotion de l'intégration et du bon fonctionnement des mécanismes de marchés ouverts et concurrentiels. Dans une bonne économie, la souveraineté n'appartient pas aux marchés, mais aux consommateurs (le marché est un outil, pas une valeur), comme on peut l'apprendre dans n'importe quel manuel d'économie élémentaire. Pour être une économie vraiment bonne, il faut que la souveraineté, la légitime, sache se défendre face aux marchés quand ceux-ci sont loin de bien fonctionner et d'être aussi ouverts qu'ils le devraient. En 700, l'effondrement d'une grande banque comme Lehman Brothers a suffi à créer la pire crise depuis 2008. L'affaire Lehman démontre que, cette fois, la crise financière ne s'est pas produite par contagion mais par l'éboulement d'un pilier qui n'était pas considéré comme porteur. La tâche de faire fonctionner les marchés n'est pas facile, mais la deuxième tâche est beaucoup plus difficile : protéger l'économie et la société. La crise des dettes souveraines en Europe a montré toutes les limites et l'incomplétude du projet européen de ce point de vue. La dimension actuelle de la finance et des marchés financiers domine celle de l'État comme elle l'était au temps de Montesquieu et même avant. Surtout dans la sphère financière, le pouvoir de marché acquis au cours des dernières décennies par certains conglomérats n'est pas tolérable en raison de la suspension du droit des faillites à leur encontre et du danger de révision de la souveraineté des États expropriés par les marchands et les banquiers (encore une fois l'histoire des seigneuries italiennes devrait enseigner). Le capitalisme sans faillite n'est plus du capitalisme. Quelqu'un truque le jeu quand l'échec devient un chantage qui remet en cause la survie du marché lui-même, avec toutes les conséquences sociales de l'affaire.
Face à cela, l'Europe n'a pas protégé son économie de la crise des marchés financiers et de la spéculation qui s'est emparée d'elle. Les droits de citoyenneté dans la zone euro (encore indéfinis) ont rapidement fondu, montrant que ce n'était pas la même chose d'avoir sa résidence dans une partie ou dans une autre. Les déséquilibres préexistants (et non convergents) se sont accentués en l'absence de règles d'ajustement précises, établies à l'avance. L'ancienne logique de représailles des fourmis sur les cigales a prévalu. Une Europe telle qu'elle existe ne protège pas les marchés ni ne nous protège des marchés et le risque que chacun se retrouve dans son caravansérail existe.
Depuis le XVIIIe siècle, certains États nationaux ont commencé à construire leur propre souveraineté à la suite tardivement de l'Angleterre qui, outre la révolution politique et le principe de l'État de droit (c'est-à-dire gouverner dans le respect de la loi), s'était dotée d'une banque de question et d'une dette publique unifiée et infaillible pour sauver son propre État de la tyrannie des marchés. L'Europe d'aujourd'hui doit encore franchir le même pas pour ne pas trahir sa tradition de civilisation ouverte. Cela implique aussi de placer la loi au-dessus de tout et de tous, avec une constitution qui ne soit pas dictée par les lobbies et les marchands, sinon, le danger est de retomber encore plus en arrière, dans une féodalité peut-être opulente, connectée via internet, mais avec de nouvelles formes de vassalité et de corvée. Quel est l'intérêt de remplacer le monde des chevaliers, des clercs et des paysans par un monde nouveau, tout technologique et composé d'une triade inquiétante et moins romanesque de sociétés mercantiles en quête de rentes, de hauts bureaucrates prêts à les offrir et de masses de prolétaires en lambeaux ? Même ainsi, le pouvoir authentique et arbitraire serait ailleurs, avec un destin qui nous échappe une fois de plus.