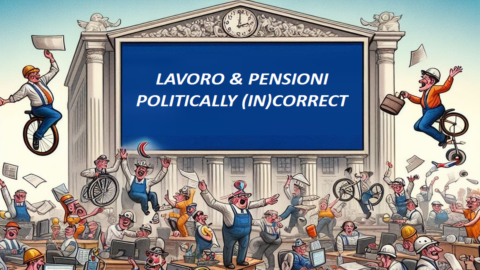« L'intervention de la BCE ? Cela fait gagner du temps. En effet longtemps, car au moins sur le papier les ressources d'une banque centrale sont infinies ». Mais les notes positives, selon le professeur Mario Noera, professeur de droit et d'économie des marchés financiers à l'Université Bocconi, s'arrêtent là. Tant sur la source de la politique européenne, "car le fonds FESF, encore sur le papier, est en tout cas né avec des moyens trop limités pour mener à bien son rôle : 440 milliards alors qu'il en faudrait au moins quatre fois plus". A la fois, surtout, parce que, en Europe comme aux USA, le monde est victime d'une limite culturelle majeure, mais aussi politique : « En l'absence de solution au problème de la répartition des richesses, qui pour trente ans se sont soldés par des bénéfices qui sont souvent réinvestis dans des actifs générateurs de revenus, mais finissent par générer des revenus, les interventions fiscales risquent de plonger le monde dans la récession ».
Un dilemme qui touche les USA, l'Europe mais aussi les pathologies de l'Italie « désormais sous commissariat ». Pourtant, la première réaction des marchés aux signaux en provenance de Francfort a été très positive. Il ne croit pas ?
« Cela ne m'étonne pas, tout comme la plus grande prudence qui a suivi ne m'étonne pas. Le signal était sans doute fort surtout parce que cette fois la Bundesbank ne s'est pas opposée à l'intervention en faveur de l'Italie et de l'Espagne. Il est aisé de comprendre que c'est le résultat d'une négociation souterraine qui a contraint l'embarrassante conférence de presse de vendredi soir sur l'exécutif italien à garantir l'authenticité de certains engagements ».
Pourquoi tant de scepticisme ?
« Si on se limite au cas italien, ils sont vraiment loin de toute solution. Nous sommes face à un ensemble hétérogène de mesures : certaines sont d'une utilité douteuse et en tout cas incertaines tant sur le comment que sur le quand. D'autres, à savoir les réformes constitutionnelles, d'une efficacité pratique douteuse. Au fond, le seul véritable changement concerne le report de l'équilibre financier à 2013, avec des procédures qui restent à vérifier. Mais, au-delà de ces perplexités, il convient de faire une réflexion plus générale, qui concerne à la fois l'Italie et les Etats-Unis ou l'Europe : les vrais problèmes ne se sont pas encore posés. Et, en raison de notre retard culturel, les dissoudre sera vraiment difficile".
La difficulté de réagir à la crise vient donc d'un fossé culturel ?
« Il n'y a pas de recette théorique pour aller au fond du problème principal : comment traiter le problème de la croissance, dont tout le monde parle, dans un contexte d'endettement ».
La solution orthodoxe considère la dette comme le principal obstacle à la croissance. D'où la nécessité de s'attaquer à la dette.
« Mais si cela se produit dans un cadre de restrictions fiscales, les conditions sont posées pour une longue stagnation incompatible avec le développement dont peuvent découler de nouvelles recettes fiscales. Cela déclenche un cercle vicieux. »
Pour en sortir, il faudrait des capitaux extérieurs. Celles de Chine, bien sûr.
« Il ne suffit pas de recevoir du capital. Il doit aussi y avoir des opportunités d'investissement. Les capitaux des pays créanciers, lorsqu'ils finissent par financer la dette, servent à stabiliser les marchés financiers. Mais de cette façon, les prémisses ne sont pas posées pour créer des revenus à l'avenir. Le problème n'est pas résolu si la question de la relance de la demande n'est pas abordée ».
On a besoin d'un nouveau Keynes, en somme ?
« Il faut étudier quelles sont les conditions pour permettre à la demande de décoller. Oui, cela vaut la peine de relire Keynes, mais surtout de redécouvrir les néo keynésiens, de Kaldor à Kaletsky, qui se sont attaqués au problème de la création et de la répartition des revenus sur le long terme. La répartition des revenus est le problème fondamental : toute politique de redressement financier qui part de la compression de la demande intérieure n'a pas de sens ».
Ces dernières années, au contraire, la richesse s'est déplacée vers le haut de la population.
"Avec pour conséquence de déchaîner les bulles et de concentrer la croissance des investissements dans le seul secteur immobilier, où se concentrent les revenus".
La recette de la BCE ne va donc pas dans le sens de l'gusta ?
« Pour l'amour du ciel, ce sont toutes des prescriptions correctes, voire nécessaires. Il est important de mettre en place des mesures favorisant l'efficacité des entreprises ou une plus grande flexibilité des coûts de main-d'œuvre. Mais les mesures du seul côté de l'offre ne suffisent pas ».
Ce n'est pas une image réconfortante.
"Je suis d'accord. Mais la seule alternative possible, si la demande intérieure ne décolle pas, est une politique très agressive sur le front des exportations, qui nécessite, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, un taux de change faible pour l'euro. Ce qui est contraire à la philosophie de la Bundesbank. Ce n'est pas seulement un problème européen. Aux États-Unis, elle a pris la saveur d'un conflit de classe : l'opposition du Tea Party et du Parti républicain a un caractère politique. L'impasse américaine, comme le note à juste titre Standard & Poor's, est de nature politique ».
Et Obama a l'air trop faible.
« C'est l'avis des marchés. En réalité, pour contrer la situation actuelle, les dépenses publiques ont dû être augmentées et une trajectoire budgétaire identifiée dans le temps. Le contraire de ce qui se passe ».
Pendant ce temps, les marchés ont manqué de dynamisme en début de séance. Son scepticisme semble justifié.
« Les marchés ne font pas de politique, mais ils aiment les solutions cohérentes. Une consolidation budgétaire qui ne résout pas le problème de la répartition conduit inévitablement à un "double dip", c'est-à-dire au risque d'une récession clairement visible aux yeux des opérateurs financiers".
Pourtant, l'intervention de la BCE marque une discontinuité historique. C'est un pas en avant ou pas ?
« Disons que la voie choisie par l'Europe est la bonne mais que l'UE l'a prise trop lentement. Le fonds européen doit intervenir rapidement et avec des moyens adéquats, ce qui suppose une unité d'intention et des choix fiscaux. En l'absence de cette stratégie, la seule institution commune, à savoir la Banque centrale européenne, a dû déménager. Et ce n'est pas une bonne chose."
Pourquoi ?
« Parce que les marchés peuvent apprécier un remplacement pourvu qu'il soit limité dans le temps. Sinon, la BCE, qui vise à contrôler l'inflation, risque de perdre la réputation qu'elle s'est forgée au fil des ans ».